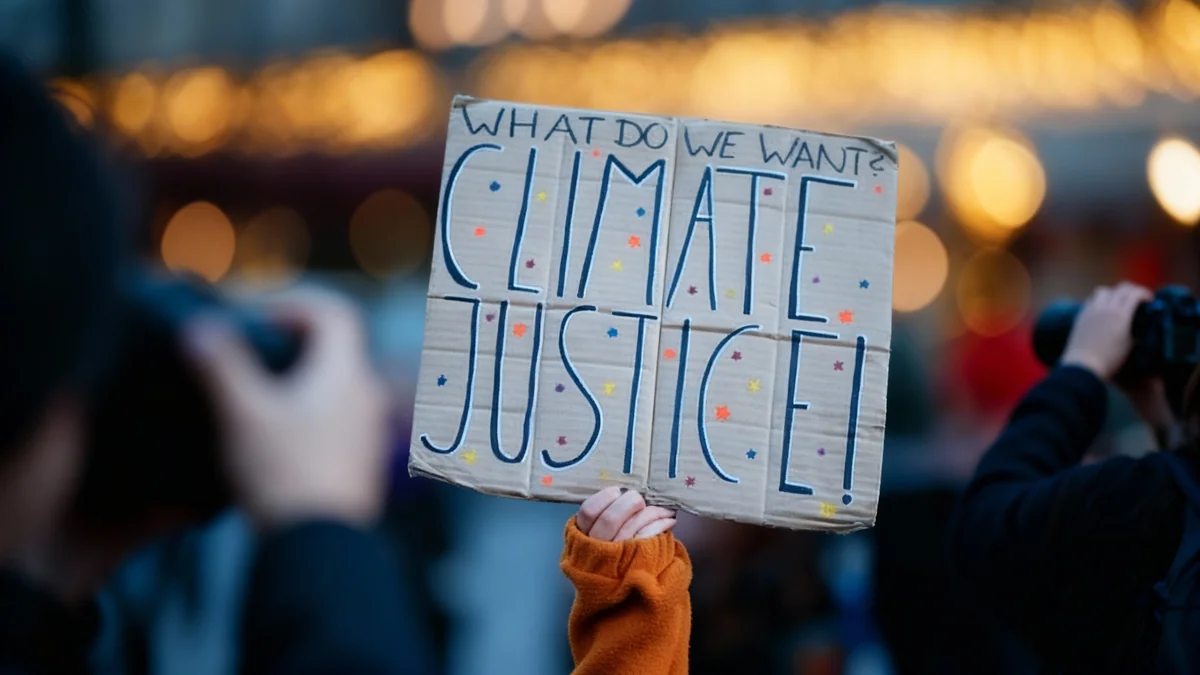Lors d'une audience à la Cour Suprême des États-Unis concernant les tarifs douaniers de l'administration Trump, un débat inattendu a émergé : un futur président pourrait-il utiliser ces mêmes pouvoirs d'urgence pour imposer des taxes sur les produits à forte intensité carbone au nom d'une « urgence climatique » ? Cette question, soulevée par le juge conservateur Neil Gorsuch, a mis en lumière les profondes implications de cette affaire pour l'avenir de la politique environnementale américaine.
La discussion a tourné autour de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), une loi que l'administration Trump a largement interprétée pour justifier ses taxes à l'importation. Les arguments présentés pourraient créer un précédent juridique limitant ou élargissant considérablement les pouvoirs du président en matière économique et climatique.
Points Clés
- Le juge Neil Gorsuch a posé une question sur l'utilisation des pouvoirs d'urgence pour imposer des tarifs climatiques.
- L'avocat du gouvernement a admis qu'une telle action serait probablement légale selon leur interprétation de la loi.
- Le débat met en jeu la « doctrine des questions majeures », qui limite le pouvoir exécutif sur les sujets d'importance économique ou politique.
- L'issue de l'affaire pourrait affecter la capacité des futurs présidents à mettre en œuvre des politiques climatiques ambitieuses.
Un Scénario Climatique au Cœur d'un Débat sur les Tarifs
L'échange le plus marquant de l'audience a eu lieu lorsque le juge Neil Gorsuch, connu pour ses positions conservatrices, s'est tourné vers l'avocat général D. John Sauer. Il a présenté une hypothèse précise : « Le président pourrait-il imposer un tarif de 50 % sur les voitures à essence et les pièces automobiles pour faire face à la menace inhabituelle et extraordinaire venue de l'étranger du changement climatique ? »
La réponse de M. Sauer a surpris une partie de l'auditoire. Il a concédé : « Il est très probable que cela puisse être fait ». Le juge Gorsuch a alors rétorqué : « Je pense que ce serait la logique de votre point de vue ».
M. Sauer a tenté de nuancer en précisant que l'administration actuelle considérait le changement climatique comme un « canular », mais a ajouté que la décision d'agir ou non reviendrait au Congrès, et non aux tribunaux, selon leur interprétation. Cet échange a immédiatement placé la question climatique au centre d'une affaire portant initialement sur le commerce international.
La Loi en Question
L'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 autorise le président à réguler le commerce international après avoir déclaré une urgence nationale en réponse à une menace inhabituelle et extraordinaire provenant de l'étranger.
La Doctrine des "Questions Majeures" comme Garde-fou
La discussion a rapidement pivoté vers un concept juridique fondamental : la « doctrine des questions majeures ». Cette doctrine, mise en avant dans l'arrêt West Virginia v. Environmental Protection Agency de 2022, stipule que sur les questions d'une grande importance politique ou économique, l'exécutif doit disposer d'une « autorisation claire du Congrès » pour agir.
Dans sa plaidoirie contre les tarifs, l'avocat Neal Katyal, représentant un distributeur de bière et de vin, a repris l'exemple du juge Gorsuch pour illustrer les dangers d'une interprétation trop large du pouvoir présidentiel.
« Si le gouvernement gagne, un autre président pourrait déclarer une 'urgence climatique' et imposer d'énormes tarifs sans planchers ni plafonds, comme l'a dit le juge Gorsuch », a averti M. Katyal.
Il a souligné l'ironie de la situation en déclarant que l'administration actuelle pourrait qualifier l'urgence climatique de canular, mais que « le prochain président pourrait ne pas dire tout à fait cela ». Cet argument visait directement l'aile conservatrice de la Cour, sensible à la limitation des pouvoirs de l'exécutif.
Un Dilemme Stratégique pour la Politique Climatique
Cette affaire judiciaire place les défenseurs de l'action climatique dans une position délicate. Limiter le pouvoir de l'administration Trump aujourd'hui pourrait involontairement entraver un futur président progressiste souhaitant utiliser des outils exécutifs robustes pour lutter contre le changement climatique.
Todd Tucker, du Roosevelt Institute, a souligné ce paradoxe. Il a écrit que des arguments juridiques trop larges contre les tarifs actuels pourraient « faire pencher la balance de manière écrasante contre les priorités progressistes » à l'avenir. Les limites imposées aujourd'hui lieront les présidents de demain, qu'ils soient centristes, progressistes ou conservateurs.
Ce dilemme reflète une tension croissante : faut-il privilégier des restrictions immédiates sur un pouvoir jugé excessif ou préserver une flexibilité exécutive pour les crises futures, y compris climatiques ?
Contexte : West Virginia v. EPA
En 2022, la Cour Suprême a utilisé la « doctrine des questions majeures » pour invalider le Clean Power Plan de l'ère Obama. La majorité conservatrice a jugé que l'Agence de protection de l'environnement (EPA) avait outrepassé son autorité en tentant de réguler les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques sans mandat explicite du Congrès. Le juge Gorsuch avait rédigé une opinion concordante détaillant sa vision de cette doctrine.
Les Réactions des Autres Juges
Les questions posées par les autres membres de la Cour ont révélé des lignes de fracture. Le président de la Cour, John Roberts, et la juge Amy Coney Barrett ont également exprimé leur scepticisme quant à l'étendue des pouvoirs revendiqués par le gouvernement. Leurs interrogations suggèrent une préoccupation partagée concernant un pouvoir présidentiel potentiellement illimité dans le domaine économique.
À l'inverse, les juges Clarence Thomas et Samuel Alito ont semblé plus favorables à la position de l'administration, proposant même des justifications juridiques alternatives pour les tarifs. Le juge Alito a notamment interpellé Neal Katyal, un démocrate ayant servi sous l'administration Obama, sur son utilisation d'arguments typiquement conservateurs sur la non-délégation du pouvoir législatif.
« Je me demande si vous avez déjà pensé que votre héritage en tant qu'avocat constitutionnel serait d'être l'homme qui a ravivé l'argument de la non-délégation », a-t-il lancé avec une pointe d'ironie.
La réponse de M. Katyal a été directe : « Absolument ». Il a réaffirmé que le juge Gorsuch avait « mis dans le mille » en soulignant le caractère exceptionnellement vague de la loi invoquée par le gouvernement.
L'issue de cette affaire reste incertaine, mais les arguments entendus devant la plus haute juridiction du pays ont déjà ouvert une nouvelle perspective sur les outils, potentiellement controversés, qui pourraient un jour être déployés dans la lutte contre le changement climatique.