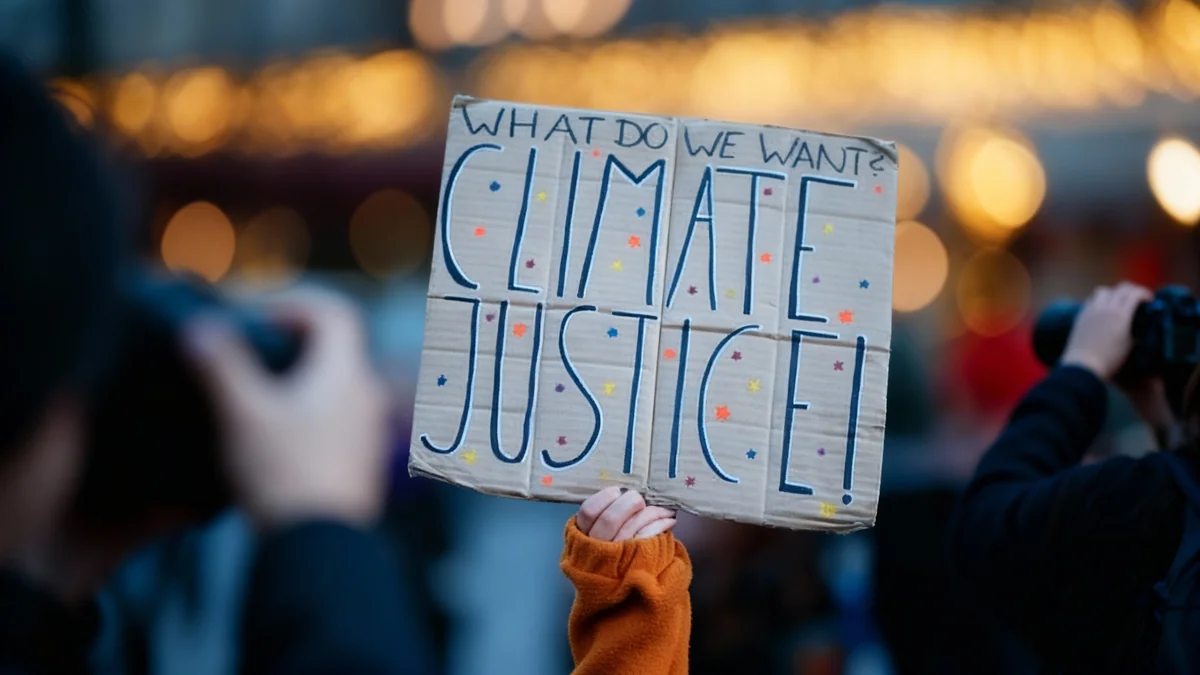Alors que les habitants des villages autochtones d'Alaska, dévastés par l'ex-typhon Halong, s'apprêtent à rentrer chez eux, les experts du climat tirent la sonnette d'alarme. Ils retournent sur des terres ancestrales confrontées à un avenir d'incertitude extrême, marqué par un cycle destructeur d'inondations, d'érosion et de tempêtes de plus en plus intenses.
La date butoir du 10 novembre fixée par l'État pour le retour approche, et avec elle, une décision historique pour ces communautés : reconstruire en défiant les éléments ou abandonner des générations d'histoire pour trouver refuge sur des terres plus élevées.
Points Clés
- Les survivants de l'ex-typhon Halong retournent dans des villages où les risques climatiques s'intensifient.
- Les communautés sont confrontées au choix difficile entre la reconstruction sur leurs terres ancestrales et une relocalisation coûteuse.
- Les scientifiques préviennent que l'érosion, la fonte du pergélisol et la montée des eaux rendent l'avenir de ces zones très incertain.
- La relocalisation d'un seul village pourrait coûter des dizaines de millions de dollars et prendre plus d'une décennie.
Un héritage culturel menacé
Pour beaucoup, le retour est empreint de douleur. Nellie Jimmie, représentante de l'État d'Alaska qui a constaté les dégâts à Toksook Bay, s'inquiète des conséquences à long terme sur les traditions culturelles transmises depuis des générations. Les pertes ne sont pas seulement matérielles.
"Il y a tellement de dégâts, des maisons sont inhabitables", explique-t-elle. "C'est beaucoup de chagrin, des gens qui perdent leur camp de pêche où leurs arrière-arrière-grands-parents ont vécu, où des membres de la famille sont nés, et tout a disparu."
Face à ce traumatisme, la question de la relocalisation gagne du terrain. Certaines communautés, comme Kwigillingok, ont déjà fait leur choix. Après un vote, ses habitants ont décidé de faire de la délocalisation leur priorité à long terme. La peur et l'expérience horrifiante de la tempête poussent certains à ne plus vouloir revenir.
"Je ne suis pas ici pour dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire, mais pour soutenir mon district dans ce qu'il souhaite faire pour son autodétermination. Mais oui, il y a des gens qui, à cause de leur expérience horrible, sont trop traumatisés pour y retourner." - Nellie Jimmie, Représentante de l'État d'Alaska
Le défi colossal de la relocalisation
Si la volonté de partir est présente, la réalité est bien plus complexe. Pour Daryl John, administrateur tribal de Kwigillingok, les efforts actuels se concentrent sur des solutions à court terme : rétablir les communications, les transports et sécuriser la piste d'atterrissage. Mais l'objectif final reste clair.
"Le plan à long terme est de se relocaliser sur des terres plus élevées", affirme-t-il, tout en demandant aux dirigeants de l'État un calendrier réaliste pour déplacer le village d'environ 43 kilomètres vers le nord.
Un coût exorbitant
Le sénateur Lyman Hoffman estime que la reconstruction de la seule école d'un village coûterait entre 40 et 80 millions de dollars. À cela s'ajoutent les coûts de la piste d'atterrissage, des cliniques et des bureaux de poste. Un projet de relocalisation complet prendrait, selon lui, "au moins 10 ans", même avec une volonté politique forte.
Cette perspective place les communautés dans une situation précaire, les forçant à investir dans des infrastructures temporaires sur des terres qu'elles savent condamnées à terme.
La science confirme les craintes
Les experts climatiques confirment que les habitants qui retournent chez eux doivent s'attendre à revivre ce type de catastrophes. Les données scientifiques dressent un tableau inquiétant pour l'avenir de la région.
Érosion et inondations : un duo destructeur
Dr. Nora Nieminski, gestionnaire du programme des risques côtiers pour la Division des études géologiques et géophysiques de l'Alaska, souligne que si la fréquence des inondations majeures n'a pas forcément augmenté, d'autres facteurs rendent la situation plus dangereuse.
Depuis l'an 2000, les habitants peuvent "s'attendre de manière fiable à ce qu'une forte tempête se produise chaque année pendant la saison d'automne". L'impact de ces tempêtes est décuplé lorsqu'elles coïncident avec les marées hautes, un phénomène qui augmente considérablement le risque d'inondation. De plus, les inondations mineures dues aux seules marées hautes sont devenues plus fréquentes.
Cependant, le plus grand danger à long terme est l'érosion. Les tempêtes accélèrent ce processus, mais des facteurs géologiques naturels y contribuent également. La dégradation du pergélisol fait monter le niveau de base des eaux, rendant toute projection sur l'habitabilité future presque impossible.
Le delta du Kuskokwim, une zone vulnérable
Rick Thoman, spécialiste du climat au Centre d'évaluation climatique de l'Alaska, explique que la région est prise en étau. Le delta du Kuskokwim est une plaine extrêmement plate, où la plupart des terres se situent à moins de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette topographie la rend particulièrement sensible aux changements environnementaux.
Thoman identifie plusieurs tendances critiques :
- Hausse des températures : L'air et l'océan se réchauffent dans le nord et l'ouest de l'Alaska.
- Fonte du pergélisol : Le sol gelé en permanence qui soutient les terres dégèle, affaiblissant le littoral.
- Montée des eaux : Le réchauffement des océans provoque leur expansion thermique.
- Disparition de la glace de mer : La banquise, qui protégeait autrefois la côte de l'érosion par les vagues, est présente moins longtemps chaque année.
"Nous sommes frappés de tous les côtés ici", résume Rick Thoman.
Un avenir à réécrire
Alors, que faire ? Selon Thoman, l'avenir de la région dépend des actions humaines. Le renforcement des infrastructures peut aider à atténuer les inondations modérées, mais il existe des limites à son efficacité face à des événements extrêmes comme Halong.
Il cite l'exemple du village de Newtok, qui est en cours de relocalisation vers un nouveau site appelé Mertarvik en raison d'une érosion fluviale sévère. C'est peut-être le sort qui attend d'autres communautés comme Kwigillingok.
Le spécialiste s'attend à ce que les inondations majeures deviennent plus courantes dans le delta du Kuskokwim au cours des 20 à 40 prochaines années. Un autre problème majeur émergera : l'intrusion d'eau salée dans les sources d'eau douce, menaçant l'approvisionnement en eau potable.
Il encourage les dirigeants des villages qui souhaitent rester à prendre leurs décisions "les yeux grands ouverts", en tenant compte de tous les facteurs. Pour les habitants qui retournent chez eux cette semaine, la question n'est pas de savoir si une autre tempête de l'ampleur de Halong frappera, mais quand.