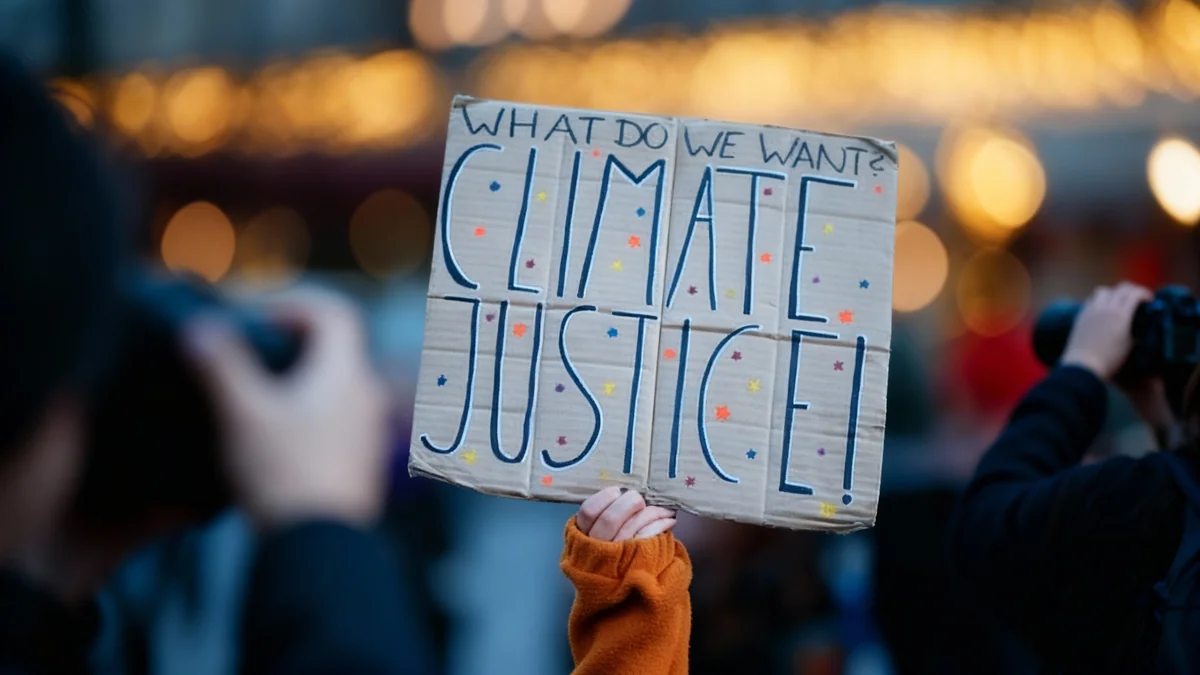Le village de Khun Samut Chin, situé à environ 50 kilomètres au sud-ouest de Bangkok, en Thaïlande, est confronté à une érosion côtière sévère. Ses habitants ont été contraints de se déplacer à quatre reprises pour échapper à la montée des eaux, perdant terres et moyens de subsistance.
Points clés
- Khun Samut Chin a perdu 6,4 km² de terres depuis les années 1990.
- L'érosion annuelle atteint 3 à 5 mètres, avec une subsidence de 1 à 2 cm par an.
- Les villageois ont dû se relocaliser quatre fois sans aide gouvernementale.
- Des facteurs humains aggravent le changement climatique : barrages, extraction d'eau souterraine, déforestation des mangroves.
- Les habitants ont lancé un programme d'accueil touristique pour financer les efforts d'atténuation.
L'urgence climatique à Khun Samut Chin
Le littoral thaïlandais est gravement touché par l'érosion, avec environ 830 kilomètres de côtes reculant chaque année à un rythme supérieur à un mètre. À Khun Samut Chin, la situation est encore plus critique. Le village subit une érosion de trois à cinq mètres par an, tandis que la terre s'affaisse d'un à deux centimètres annuellement. Depuis les années 1990, environ 4 000 rai, soit 6,4 kilomètres carrés, ont été engloutis par la mer.
Le temple bouddhiste, autrefois au cœur du village, se dresse désormais seul sur une petite parcelle de terre qui s'avance dans la mer, au point que les habitants l'appellent le « temple flottant ».
Un fait alarmant
Environ 410 millions de personnes, dont 59 % en Asie tropicale, pourraient être touchées par la montée du niveau de la mer d'ici 2100.
Causes multiples de la catastrophe
L'érosion sévère de Khun Samut Chin est partiellement due au changement climatique. Cependant, d'autres facteurs d'origine humaine aggravent la situation. Les barrages construits en amont pour le contrôle des inondations et l'irrigation ont réduit les flux de sédiments dans le delta du fleuve Chao Phraya, où se trouve le village. Cette réduction prive le littoral des apports naturels nécessaires à sa reconstitution.
De plus, l'extraction excessive d'eau souterraine par les industries voisines a intensifié l'affaissement des terres. La construction d'étangs artificiels pour l'élevage commercial de crevettes a entraîné un défrichage massif des forêts de mangroves. Ces mangroves jouaient autrefois un rôle crucial de tampon contre l'érosion côtière, protégeant naturellement le village.
Wisanu, le chef du village, déclare que les politiciens thaïlandais donnent la priorité aux centres urbains et industriels en raison de leur poids électoral et économique.
Des déplacements forcés et un manque de soutien
Les villageois ont été contraints de déménager quatre fois, perdant leurs terres et leurs moyens de subsistance à chaque déplacement. Le gouvernement n'a fourni aucune compensation pour les maisons endommagées ni d'aide financière pour les relocalisations. Cette absence de soutien a des conséquences profondes sur la communauté.
Beaucoup de jeunes, lassés des déplacements constants et de la difficulté croissante à trouver du poisson en raison de l'envasement de la mer, sont partis chercher du travail à Bangkok. Ils y occupent des emplois sur les chantiers de construction, dans les usines et d'autres secteurs. Les personnes âgées constituent aujourd'hui la majorité des habitants restants. L'école locale ne compte que quatre élèves, ce qui en fait la plus petite de Thaïlande.
Plans d'adaptation théoriques
Les plans d'adaptation officiels sont des stratégies dirigées par l'État pour aider les communautés à faire face au changement climatique. En théorie, l'État décide des déplacements, construit des structures de protection et fournit des fonds. En pratique, des communautés comme Khun Samut Chin reçoivent peu ou pas d'aide.
La résilience des habitants
Face à l'inaction du gouvernement, les villageois de Khun Samut Chin ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont mis en place un programme d'accueil chez l'habitant. Une dizaine de foyers, dont celui du chef du village, hébergent des touristes. Ces derniers paient entre 600 et 700 bahts (environ 13 à 16 livres sterling) par nuit.
Une partie de cette somme, 50 bahts, est reversée à un fonds communautaire. Ce fonds sert à financer les efforts d'atténuation de l'érosion, comme l'achat ou la réparation de digues en bambou. Le programme est promu via Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux. Il propose aux visiteurs de découvrir la vie en première ligne du changement climatique, de visiter le temple, de participer à la replantation de mangroves et d'acheter de la nourriture aux villageois.
- 600-700 Bahts par nuit pour un séjour chez l'habitant.
- 50 Bahts sont alloués au fonds communautaire pour l'érosion.
- Les activités incluent la replantation de mangroves et l'achat de produits locaux.
Wisanu, dont le foyer gère cinq gîtes, explique que le programme « nous permet de ne pas devenir riches, mais de continuer à avancer ». Les villageois croient que cette initiative aide également à sensibiliser le public à leur sort. Ils ont également fait pression sur le gouvernement local pour maintenir l'école ouverte et reconstruire un centre de santé endommagé par une tempête.
Un exemple de résilience
Le programme d'accueil chez l'habitant non seulement génère des revenus, mais permet aussi de sensibiliser le public à la lutte de la communauté contre l'érosion et le changement climatique.
Un avertissement pour l'avenir
Khun Samut Chin offre un aperçu de ce que de nombreuses autres communautés côtières pourraient affronter à l'avenir. Il démontre que le « retrait géré » n'est souvent pas géré du tout, du moins pas par l'État. Les cadres mondiaux, comme l'Accord de Paris et les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), partent du principe que les gouvernements ont la capacité et la volonté politique de planifier et de financer les efforts d'adaptation côtière.
Cependant, Khun Samut Chin montre à quel point la réalité peut s'éloigner de ces hypothèses. La mer avance, l'État est absent, et les villageois sont en grande partie livrés à eux-mêmes. Pourtant, ils refusent d'abandonner. Ils continuent de rester, d'accueillir des touristes, de replanter des mangroves, de réparer les digues en bambou et de résister à la disparition de leur village. Ils se battent non seulement contre l'érosion, mais aussi contre la négligence politique. Si les gouvernements et les institutions mondiales ne les aident pas, cette communauté sera emportée non seulement par l'eau, mais aussi par notre inaction collective.