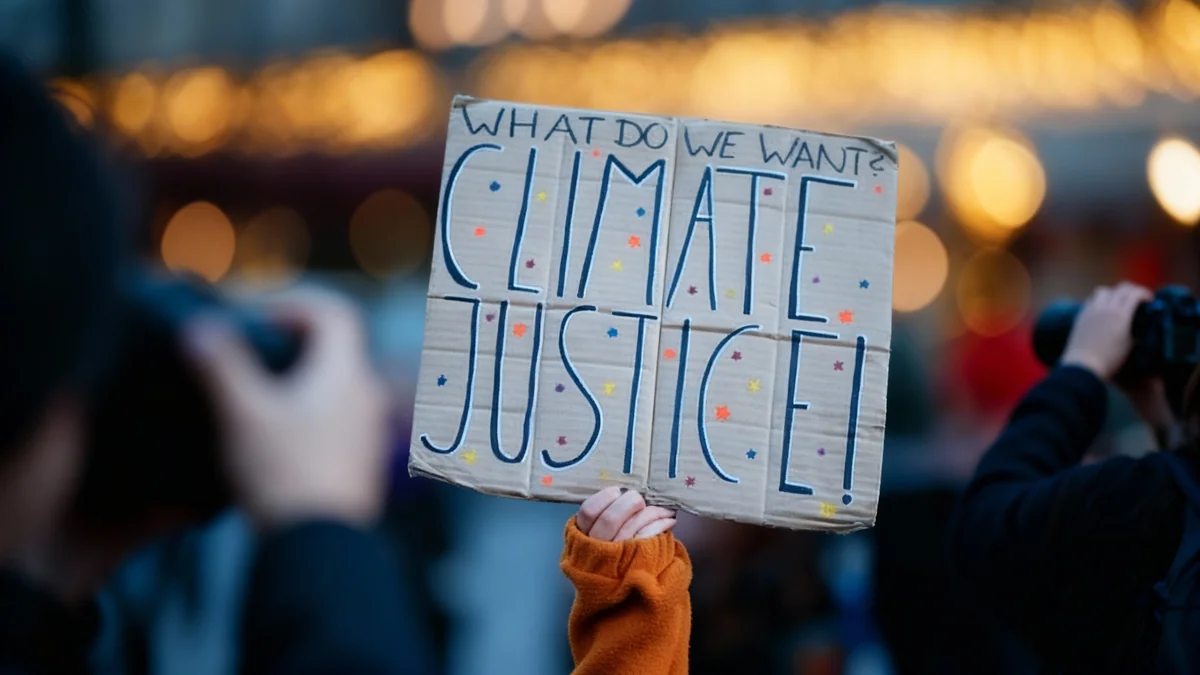Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature Climate Change révèle une disparité frappante dans la responsabilité du réchauffement climatique. Selon les chercheurs, les 10 % d'individus les plus riches de la planète sont à l'origine de deux tiers du réchauffement observé depuis 1990, soulignant le rôle prépondérant de la richesse concentrée et des investissements financiers dans l'intensification des événements climatiques extrêmes.
Points Clés
- Les 10 % les plus riches ont causé deux tiers du réchauffement climatique depuis 1990.
- Le 1 % le plus riche contribue 26 fois plus aux vagues de chaleur extrêmes que la moyenne mondiale.
- L'étude met en évidence les émissions liées aux investissements financiers, au-delà du simple mode de vie.
- Une fiscalité progressive sur la richesse et les actifs à forte intensité carbone est suggérée comme solution équitable.
Une responsabilité climatique fortement inégale
La recherche sur le changement climatique se concentre souvent sur la responsabilité des nations. Cependant, cette nouvelle analyse établit un lien direct entre les empreintes carbone des individus les plus fortunés et des impacts climatiques concrets. L'étude montre que la concentration de la richesse exacerbe directement les risques climatiques pour tous.
Sarah Schoengart, auteure principale de l'étude et scientifique à l'ETH Zurich, explique que cette recherche marque une transition. Il ne s'agit plus seulement de comptabiliser les émissions de carbone, mais d'attribuer une responsabilité claire pour leurs conséquences climatiques.
Des chiffres qui interpellent
Selon l'étude, le 1 % le plus riche de la population mondiale contribue 26 fois plus aux vagues de chaleur qui ne devraient se produire qu'une fois par siècle, et 17 fois plus aux sécheresses dans la forêt amazonienne, par rapport à la moyenne mondiale. Cette statistique illustre l'influence démesurée d'une petite fraction de la population.
Les chercheurs ont également constaté que les émissions provenant des 10 % les plus riches aux États-Unis et en Chine ont considérablement augmenté la fréquence des événements de chaleur extrême. Ces deux pays représentent à eux seuls près de la moitié de la pollution carbone mondiale, ce qui souligne l'importance d'une action ciblée.
L'importance des émissions liées aux investissements
Une des contributions majeures de cette étude est de mettre l'accent sur les émissions « intégrées » dans les investissements financiers. Celles-ci s'ajoutent aux émissions générées par le mode de vie et la consommation personnelle. Les choix d'investissement des plus riches ont un impact climatique considérable.
« Une action climatique qui ne prend pas en compte les responsabilités des plus riches risque de négliger un levier crucial pour réduire les dommages futurs », a déclaré Carl-Friedrich Schleussner, auteur senior de l'étude.
Les auteurs suggèrent que les détenteurs de capitaux pourraient être tenus responsables par le biais d'impôts progressifs sur la fortune et sur les investissements à forte intensité de carbone. Cette approche est jugée plus équitable que les taxes carbone généralisées, qui ont tendance à pénaliser davantage les ménages à faibles revenus.
Qu'est-ce que les émissions intégrées ?
Les émissions intégrées (ou « embedded emissions ») font référence aux gaz à effet de serre émis tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service, y compris ceux financés par un investissement. Par exemple, investir dans une entreprise pétrolière signifie être indirectement responsable des émissions générées par l'extraction, le raffinage et la combustion de ce pétrole.
Les défis politiques d'une fiscalité mondiale
Malgré la pertinence de ces recommandations, la mise en place d'une fiscalité ciblant les plus fortunés se heurte à des obstacles politiques et économiques importants. Les initiatives visant à taxer les ultra-riches et les multinationales peinent à se concrétiser.
Les initiatives récentes et leurs difficultés
L'année dernière, le Brésil, en tant que pays hôte du G20, a proposé une taxe de 2 % sur la fortune nette des personnes possédant plus d'un milliard de dollars d'actifs. Bien que les dirigeants du G20 aient convenu de coopérer sur le sujet, aucune mesure concrète n'a encore été adoptée.
De même, en 2021, près de 140 pays se sont accordés pour travailler sur un impôt mondial sur les sociétés multinationales, avec un taux minimum de 15 %. Cependant, ces négociations sont au point mort, illustrant la difficulté d'obtenir un consensus mondial sur des questions fiscales complexes.
Un fossé des richesses qui se creuse
Le contexte de cette étude est celui d'une inégalité de richesse croissante. Des rapports récents de l'ONG Oxfam indiquent que le 1 % le plus riche a accumulé 42 000 milliards de dollars de nouvelles richesses au cours de la dernière décennie.
Cette concentration de la richesse n'est pas seulement une préoccupation sociale et économique, mais aussi un défi environnemental majeur. Selon Oxfam, le 1 % le plus riche possède plus de patrimoine que les 95 % les moins riches réunis. Cette situation souligne la nécessité d'interventions politiques ciblées.
Pour faire face à la crise climatique, une approche globale est nécessaire. Elle doit inclure la responsabilisation des plus riches pour leurs contributions disproportionnées. En se concentrant à la fois sur les émissions liées au mode de vie et sur celles des investissements financiers, les décideurs politiques peuvent élaborer des stratégies plus efficaces pour atténuer les impacts climatiques et promouvoir une transition juste et durable.