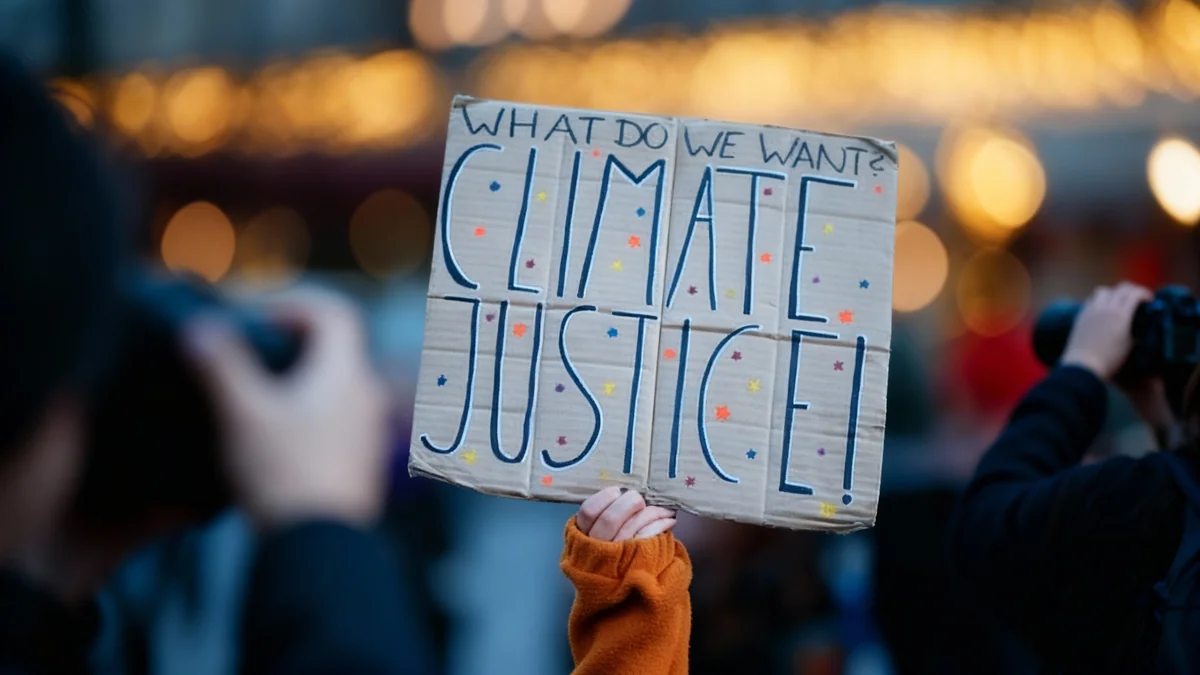Les habitants des bidonvilles de Nairobi, au Kenya, sont confrontés à une combinaison dévastatrice de chômage, de pauvreté, de criminalité et de crise climatique. Cette situation rend la vie insupportable dans ces quartiers informels. Les coupures dans les programmes d'aide internationale réduisent le peu de soutien disponible, exacerbant les difficultés quotidiennes.
Points clés
- Les bidonvilles de Nairobi subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique.
- La hausse des prix alimentaires est directement liée aux sécheresses et inondations.
- Les inondations de 2024 ont provoqué des déplacements massifs et des démolitions de logements.
- Les coupures d'aide internationale réduisent le soutien vital aux communautés vulnérables.
- Des organisations locales comme AWAK offrent des solutions économiques pour l'adaptation.
Impacts du changement climatique sur les populations vulnérables
Dans le bidonville de Kawangare, l'un des nombreux établissements informels de Nairobi, Jen, 59 ans, vit avec une anxiété constante face aux conditions météorologiques. Les sécheresses et les inondations qui frappent son quartier deviennent chaque année plus fréquentes et plus intenses. Elles menacent directement la vie des habitants.
« La vie a toujours été difficile dans les bidonvilles : la nourriture et l'eau sont rares, et il y a beaucoup de monde », explique Jen, qui habite Kawangare depuis 1989. « Mais avec le changement climatique, les choses deviennent vraiment plus dures. »
Faits marquants
- En 2019, environ 200 bidonvilles occupaient 6 % du territoire de Nairobi.
- Ces bidonvilles abritaient environ 60 % de la population totale de la ville.
- À l'échelle mondiale, environ 1,1 milliard de personnes vivent dans des établissements informels.
La flambée des prix alimentaires due aux sécheresses
Lorsque les saisons des pluies échouent au Kenya, l'impact principal pour les habitants des bidonvilles est la hausse du prix des denrées alimentaires. « Quand il y a sécheresse, moins de nourriture vient des zones rurales, ce qui signifie que peu de nourriture nous parvient ici », explique Jen.
Les conditions météorologiques extrêmes ont contribué à une inflation alimentaire importante ces dernières années. Jen décrit comment une boîte de 2 kg de graisse de kasuku, l'huile végétale de base au Kenya, est passée de 98 shillings (environ 0,56 £) il y a sept ans à près de 800 shillings (environ 4,50 £) aujourd'hui. La majeure partie de cette augmentation a eu lieu au cours des deux dernières années.
« Quand il y a sécheresse, moins de nourriture vient des zones rurales, ce qui signifie que peu de nourriture nous parvient ici. » — Jen, habitante de Kawangare.
Contexte économique
Le phénomène lié au climat ne montre aucun signe de ralentissement. Le taux d'inflation national de 4,1 % enregistré en août était tiré par une augmentation de 8,3 % du coût de la nourriture, selon le Bureau national des statistiques du Kenya. Des précipitations inférieures à la normale prévues pour la Corne de l'Afrique en fin d'année risquent également d'aggraver l'inflation en raison de leur impact sur l'élevage et la production agricole.
Inondations récurrentes et risques sanitaires accrus
L'autre événement météorologique majeur lié au climat qui frappe les bidonvilles est l'inondation. Ces dernières années, les inondations sont devenues une préoccupation majeure pour les habitants. Par exemple, les inondations de mars à mai 2024 ont provoqué le débordement des cours d'eau dans tout le comté de Nairobi, entraînant plusieurs décès et le déplacement de milliers de personnes.
Dans les ruelles étroites des bidonvilles, les eaux de crue ont dissous les chemins de terre et se sont mélangées aux eaux usées et aux déchets, formant un bourbier toxique qui a pénétré dans les maisons. Consolata, une veuve de 50 ans vivant près de Jen dans une cabane en tôle ondulée, a été directement touchée. Les inondations l'ont forcée, elle et sa famille – y compris deux enfants et quatre petits-enfants – à quitter leur domicile pendant un mois.
« Il y avait de l'eau dans la cour et dans toute la maison. Nous ne pouvions pas travailler, nous avons dû partir », raconte Consolata. « Chaque fois qu'il pleut maintenant, j'ai peur que les inondations ne reviennent. »
Conséquences des pratiques de construction précaires
Les pratiques de construction inadéquates dans les bidonvilles signifient que même les années où les précipitations sont moins extrêmes, certains ménages sont à risque. Le bâtiment en face de celui de Jen est construit sur une bande de terre autrefois utilisée pour le drainage des eaux de crue. Cela signifie que lors des pluies du début de 2025, six familles du rez-de-chaussée ont été forcées d'évacuer en raison des inondations.
La fréquence croissante des inondations augmente également le risque de maladies d'origine hydrique. En désignant de l'autre côté de la route, Jen montre un autre bâtiment où, il y a trois ans, « beaucoup de gens sont morts » du choléra, dit-elle. « En raison de la forte population, les gens construisent des maisons de plus en plus proches. Cela signifie que lorsque les inondations arrivent, les eaux ne peuvent pas s'écouler, et tout le monde est affecté », explique-t-elle, ajoutant que cela fait également grimper les loyers, car les personnes déplacées exercent une plus grande pression sur les logements restants.
Réponse gouvernementale et insuffisances de l'aide
Malgré la position pro-climat affichée par le gouvernement kényan sur la scène internationale, sa réponse à la crise climatique dans les bidonvilles du pays a été jugée gravement insuffisante par les experts.
Après les inondations de 2024, le gouvernement a déclaré que les installations le long des rives des rivières de Nairobi n'étaient plus autorisées. Il a lancé un programme de démolition de bâtiments. Dans la vallée de Mathare, qui comprend 13 bidonvilles, quelque 5 076 structures ont été démolies, affectant 6 443 ménages, selon les chiffres de l'ONG Slum Dwellers International. Cependant, les familles déplacées ne sont pas correctement indemnisées ni relogées. Elles sont depuis retournées dans les zones inondables faute d'autre endroit où aller, selon Joe Muturi, président mondial de Slum Dwellers International, basé à Nairobi.
« Les familles ont reçu 10 000 shillings (environ 60 £) en compensation… qui sont de toute façon détournés », déclare Joe Muturi. « Les inondations n'avaient rien à voir avec les habitants d'ici. Pourtant, tout ce qui se passe en amont – eaux usées, ordures, mauvaise planification urbaine – a fait que les habitants des bidonvilles ont souffert. Les gens ont absolument tout perdu, puis le gouvernement est arrivé avec ses bulldozers et a tout aggravé. »
Chiffres clés des démolitions
- 5 076 structures démolies dans la vallée de Mathare.
- 6 443 ménages affectés par ces démolitions.
- 10 000 shillings (environ 60 £) de compensation par famille, souvent détournés.
Les problèmes rencontrés dans les bidonvilles sont symptomatiques d'un échec plus large de la planification face à la crise climatique dans la ville. « La loi sur le changement climatique du comté de Nairobi est simplement copiée-collée de la première stratégie produite par des consultants, qui n'a jamais été mise en œuvre », explique Muturi. Mais les bidonvilles, qui n'apparaissent pas sur les cartes officielles de la ville, ne sont même pas couverts par ce plan. « Ces gens sont déjà dans une situation désespérée avant même le changement climatique. Ils n'ont pas d'adresses, pas de droits fonciers sécurisés, et pas de services de base comme l'approvisionnement en eau », dit-il. « Puis le gouvernement dit qu'il ne peut pas apporter d'infrastructures ou d'écoles parce qu'elles sont construites sur des terrains privés. »
Le comté de Nairobi n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur ces affirmations.
Initiatives locales et défis persistants
Face à l'escalade des impacts météorologiques extrêmes et au peu de soutien des autorités, les millions d'habitants des bidonvilles de Nairobi ont peu d'options pour s'adapter à la crise climatique. Une organisation sur le terrain qui tente d'aider est l'Association des femmes en agriculture du Kenya (AWAK).
AWAK a introduit des activités économiques à petite échelle, notamment la culture de légumes et la fabrication de briquettes, faites à partir d'une combinaison de déchets organiques et de poussière de charbon de bois. De telles activités, selon Julius Mundia, responsable de programme d'AWAK, aident les gens face au défi climatique en leur fournissant un revenu régulier et un approvisionnement constant en légumes qui « peuvent devenir très chers pendant les sécheresses ».
L'autonomisation par l'agriculture urbaine
Sur le toit de son immeuble, Jen montre fièrement d'innombrables jardinières remplies de choux, de laitues, d'oignons, de haricots et de tomates. Après avoir été formée par AWAK, elle collecte l'eau de pluie dans de grands réservoirs pour arroser ses plantes et vend ses produits sur le marché. Ce travail a fourni à sa famille un revenu crucial après que son mari a perdu son emploi.
« Quand il n'y a pas de nourriture à la maison, l'homme est souvent en colère. Cela signifie que la violence basée sur le genre peut être un gros problème dans les bidonvilles », explique Jen. « Mais quand une femme génère son propre revenu, elle est plus respectée et elle a sa place à la table des négociations », ajoute-t-elle, expliquant comment cela contribue à l'autonomisation des femmes dans les bidonvilles.
Consolata, également formée par AWAK, fabrique des briquettes de charbon de bois qu'elle vend. Elle mélange de la farine de maïs, de la poussière de charbon de bois et de l'eau, avant de les laisser sécher au soleil. « Avant, je lavais des vêtements pour les gens, mais maintenant je peux gagner plus d'argent et même en mettre un peu à la banque », dit-elle.
La criminalité et les coupes budgétaires
À quelques kilomètres de Kawangare se trouve un autre bidonville appelé Korogocho. Lydia, 38 ans, et son ami Patrick, 30 ans, y louent une parcelle de terre derrière une clôture en tôle ondulée où ils cultivent leurs propres légumes après une formation d'AWAK. Rosemary, 32 ans, et son amie Ann, 34 ans, y fabriquent des briquettes.
Patrick et Ann étaient auparavant des criminels à temps plein, extorquant de l'argent avec des couteaux ou de fausses armes. Rosemary, quant à elle, a récemment pris en charge ses deux neveux, en plus de ses deux propres fils, après le décès de son frère par empoisonnement au méthanol et l'abandon des enfants par sa belle-sœur. Les trois femmes sont des mères célibataires, et leurs histoires témoignent des graves problèmes sociaux qui gangrènent les rues des bidonvilles, où la criminalité est endémique, la présence policière quasi inexistante, et les taux de fréquentation scolaire très bas.
Le chemin hors de la criminalité
Interrogé sur les raisons de son abandon de la criminalité, Patrick explique que « tous les autres membres du gang ont été tués » et qu'il a simplement décidé : « Je ne veux plus faire ça. » Ann confirme : « Voir tant d'amis mourir était insupportable. » Tous sont reconnaissants de l'opportunité que ces activités économiques à petite échelle leur ont offerte pour briser le cycle de la pauvreté chronique, du chômage et de la criminalité qui domine la vie dans les bidonvilles. « Ce qu'AWAK a fait est vraiment incroyable… sans eux, je ne sais pas où nous serions en ce moment », déclare Rosemary.
Mais le soutien d'AWAK ne peut aller que si loin face à la menace posée par le changement climatique, qui amplifie les défis économiques. Lydia avait auparavant une autre ferme soutenue par AWAK qui a été perdue lorsque la rivière a débordé en 2024, et pour laquelle elle n'a reçu aucune compensation : « J'ai dû tout recommencer à zéro », dit-elle. Avec sa nouvelle parcelle de terre, le loyer est devenu une grande préoccupation – à tel point qu'elle ne sait pas combien de temps elle pourra la garder – tout comme la capacité à stocker suffisamment d'eau pour répondre aux besoins de ses plantes pendant les saisons sèches. « La vie est si dure ici, vraiment si dure », dit-elle. « Parfois, je regarde juste mes enfants et je pleure. »
Impacts des coupes budgétaires sur l'aide
- World Vision, une ONG, offrait auparavant des emplois de soignants et couvrait des frais de scolarité.
- L'USAID a mis fin à des programmes d'une valeur de près de 100 millions de dollars plus tôt que prévu.
- AWAK dépend désormais d'un seul bailleur de fonds, Oxfam, après avoir perdu d'autres partenaires.
- Les services liés au VIH ont été affectés, entraînant des décès et une augmentation de la criminalité.
Lydia a constaté l'impact des coupes budgétaires sur les habitants des bidonvilles. Elle raconte comment l'ONG World Vision « nous donnait des emplois d'aidants dans la communauté » et couvrait également une partie des frais de scolarité. « Maintenant, ils sont partis, et les enfants vont à la décharge pour chercher de la nourriture. » La grande majorité des enfants de Korogocho ne sont pas scolarisés régulièrement, dit Lydia, qui ajoute que sur ses quatre enfants, elle ne peut actuellement en payer qu'un seul pour une éducation permanente.
World Vision a été l'une des organisations les plus touchées par la fermeture de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) par Donald Trump plus tôt cette année. Des programmes d'une valeur de près de 100 millions de dollars (environ 75 millions de livres sterling) ont été interrompus prématurément, selon des documents divulgués et analysés par The Independent. Les réductions d'aide limitent également l'impact d'AWAK : l'ONG recevait auparavant des fonds de plusieurs partenaires, y compris l'USAID, mais il ne lui reste plus qu'un seul bailleur de fonds, Oxfam. « En ce moment, nous avons un gros problème à AWAK : nous manquons vraiment de fonds. Idéalement, nous aurions des femmes comme Jen pour en former d'autres, mais actuellement, nous ne pouvons pas nous le permettre », déclare Julius Mundia d'AWAK.
À Kawangare, Jen a également constaté les impacts des coupes budgétaires sur les services liés au VIH pour les personnes vivant avec le VIH dans les bidonvilles. « Il y a une église au coin de la rue où allaient les femmes touchées par le VIH », dit-elle. « J'ai entendu parler de trois femmes qui sont décédées cette année parce qu'elles ne recevaient plus de soutien des ONG. » Jen ajoute également que davantage de femmes ont été poussées vers la criminalité et la prostitution à la suite des difficultés économiques engendrées par les coupes budgétaires. « Les coupes de financement ont affecté les jeunes mères, qui ne sont plus en mesure de gagner leur vie, donc bien sûr, la criminalité a augmenté. C'est comme ça ici. »
L'espoir d'un changement et la COP30
Dans quelques semaines, les dirigeants mondiaux se réuniront à la COP30 au Brésil, dans le but d'élaborer une feuille de route pour faire face à la crise climatique. Mais Joe Muturi, de Slum Dwellers International, a peu d'espoir que les populations urbaines pauvres soient réellement prises en compte. « Ces sommets climatiques se déroulent dans de beaux endroits exotiques, ce qui est toujours à des années-lumière de ce qui se passe réellement dans la vie des gens », dit-il.
« Nous n'avons pas besoin de solutions sophistiquées fabriquées à Londres ou à New York, mais plutôt de solutions locales qui placent la communauté au cœur de leurs préoccupations. » Pour que ce changement se produise – et pour que des programmes comme celui géré par AWAK gagnent en importance – il faudra un changement radical dans l'approche de la politique climatique et une réelle reconnaissance de la crise quotidienne vécue par tant de personnes. Pour Muturi, cela commence par un changement d'attitude, sans plus d'euphémismes tels que la description des habitants des bidonvilles comme « résilients » : « Appeler les habitants des bidonvilles 'résilients', c'est comme jeter quelqu'un qui ne sait pas nager dans une piscine de requins, puis le féliciter quand il survit d'une manière ou d'une autre », dit-il.
Pour ceux qui sont sur le terrain, il n'y a actuellement que peu d'options autres que de faire bonne figure et de supporter. « Ce que nous espérons tous, c'est qu'un jour un bon Samaritain vienne nous sauver de nos vies ici », déclare Rosemary, de Korogocho. « J'espère juste qu'un jour j'y arriverai et que je pourrai envoyer mes garçons à l'école. »