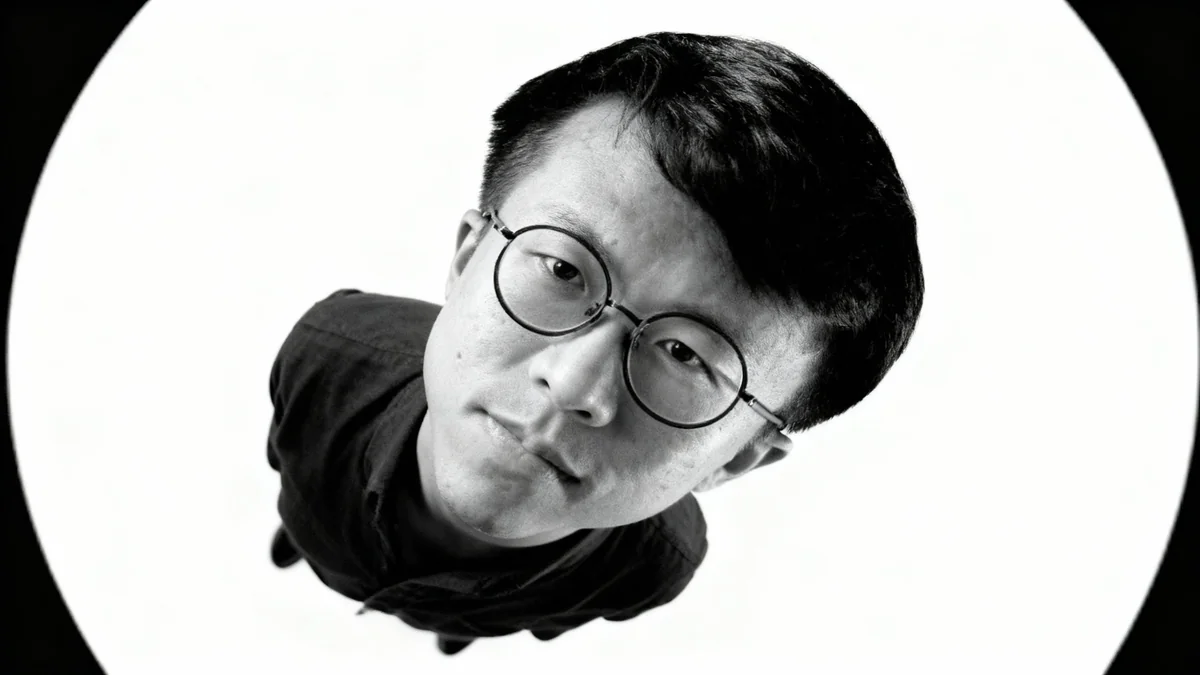Des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont mis au point une série d'équations mathématiques pour prédire la taille des lacs qui se forment à la surface des calottes glaciaires en Antarctique. Cette avancée, publiée dans la revue Nature Communications, fournit un outil crucial pour améliorer la précision des modèles climatiques actuels.
L'étude établit un lien direct entre la topographie de la glace et les dimensions des lacs d'eau de fonte, notamment leur profondeur et leur superficie. Ces nouvelles équations permettent d'intégrer des données concrètes sur un phénomène qui joue un rôle important dans la stabilité des glaces polaires.
Points Clés
- Une nouvelle formule mathématique prédit la profondeur et la superficie des lacs de fonte en Antarctique.
- La taille des lacs est directement liée à la rugosité de la surface de la calotte glaciaire.
- Les prédictions indiquent que la plupart des lacs seront peu profonds (moins de 1 mètre) mais couvriront jusqu'à 40 % de la surface de la glace.
- Cet outil est conçu pour être facilement intégré dans les modèles climatiques existants afin d'améliorer leur fiabilité.
Un chaînon manquant pour les modèles climatiques
Les lacs d'eau de fonte, appelés lacs supraglaciaires, ont une influence significative sur le comportement des calottes glaciaires. Cependant, leur formation et leur évolution étaient jusqu'à présent mal représentées dans les simulations climatiques. Certains modèles ignoraient complètement leur existence, tandis que d'autres simulaient une croissance continue jusqu'à l'effondrement de la glace.
"Les lacs de fonte jouent un rôle important dans la stabilité de la calotte glaciaire, mais auparavant, il n'y avait aucune contrainte sur la taille maximale que nous pouvions attendre d'eux en Antarctique", explique Danielle Grau, doctorante à la School of Earth and Atmospheric Sciences et auteure principale de l'étude.
L'importance des lacs supraglaciaires
Les lacs qui se forment à la surface de la glace peuvent avoir plusieurs effets. Leur couleur sombre absorbe plus de rayonnement solaire que la glace blanche, accélérant la fonte locale. De plus, l'eau peut s'infiltrer à travers des crevasses jusqu'à la base de la calotte glaciaire, agissant comme un lubrifiant qui peut accélérer le glissement de la glace vers l'océan, contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer.
Le professeur Alexander Robel, conseiller de Danielle Grau, souligne l'importance de cette nouvelle approche. "De nombreux modèles n'incluent aucune donnée sur les lacs à la surface des calottes glaciaires, tandis que d'autres simulent la croissance de ces lacs de fonte jusqu'à l'effondrement de la glace", dit-il. "Nos résultats montrent que la réalité se situe quelque part entre les deux."
"Cela nous donne des chiffres réels et concrets à utiliser dans les modèles climatiques", ajoute Alexander Robel.
De la théorie à la modélisation
Le projet a commencé lorsque Danielle Grau était encore étudiante de premier cycle. Inspirée par des recherches sur les lacs terrestres, elle a exploré avec le professeur Robel une propriété appelée "auto-affinité", qui décrit la rugosité d'une surface à différentes échelles. L'idée était de voir si ce concept pouvait s'appliquer à la topographie de la calotte glaciaire antarctique.
"Une étude précédente avait utilisé cette propriété pour prédire la taille des lacs et étangs terrestres, et nous étions curieux de savoir si nous pouvions utiliser une approche similaire pour les lacs supraglaciaires en Antarctique", précise Danielle Grau.
En confirmant que la surface de la glace antarctique possédait bien cette propriété, l'équipe a pu poursuivre ses recherches. Ils ont développé un modèle informatique, un "glacier dans un ordinateur", pour simuler l'accumulation et le mouvement de l'eau de fonte sur des milliers de scénarios topographiques différents.
Prédictions clés de l'étude
Les équations développées par l'équipe prévoient que la majorité des lacs de fonte seront peu profonds, avec une profondeur inférieure à un mètre. Cependant, ils pourraient collectivement couvrir une surface considérable, jusqu'à 40 % de la superficie de la calotte glaciaire dans les zones de fonte.
"Nous avons conçu un algorithme et l'avons intégré dans un modèle que le GT Ice & Climate Group a utilisé par le passé", explique Grau. "À partir de là, nous avons pu voir comment les lacs se formeraient sur différentes surfaces à travers des milliers de scénarios. C'était la base des équations mathématiques que j'ai développées."
Validation par imagerie satellite
Pour vérifier la validité de leurs équations, les chercheurs se sont tournés vers des données du monde réel. Ils ont fait appel à Azeez Hussain, alors étudiant en physique, pour analyser des images satellites du programme Landsat, qui photographie la surface de la Terre en haute résolution.
Hussain a examiné les images pour mesurer la taille de lacs supraglaciaires existants et analyser la topographie de la glace environnante. Les mesures effectuées à partir des données satellites ont montré une forte corrélation avec les prédictions du modèle mathématique.
"C'était passionnant de voir à quel point nos prédictions correspondaient à ce que nous observions dans l'imagerie satellite", commente le professeur Robel. Cette correspondance confirme que leur solution est une méthode fiable pour que les modèles climatiques puissent intégrer de manière réaliste les lacs supraglaciaires.
- Étape 1 : Étude de la propriété d'"auto-affinité" de la surface de la glace.
- Étape 2 : Développement d'un modèle informatique simulant des milliers de scénarios de fonte.
- Étape 3 : Création d'équations mathématiques simples basées sur les résultats des simulations.
- Étape 4 : Validation des équations en les comparant à des données satellites réelles de lacs existants.
Une application concrète pour l'avenir
L'impact de cette recherche est déjà tangible. Danielle Grau travaille actuellement à l'intégration de ces nouvelles équations dans un modèle atmosphérique utilisé par la NASA, ainsi que dans un modèle de calotte glaciaire développé conjointement par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA et le Dartmouth College.
En transformant des simulations complexes et des données satellites en formules prédictives simples, l'équipe offre aux climatologues un outil efficace pour affiner leurs projections. Bien que ce ne soit qu'un élément du puzzle climatique global, il constitue une avancée significative dans la compréhension de la réponse des glaces polaires au réchauffement de la planète.
"C'est une petite pièce du puzzle, mais une qui nous aide à comprendre comment les calottes glaciaires réagissent à un monde qui se réchauffe", conclut Danielle Grau.
Cette recherche fournit des bases quantitatives essentielles pour évaluer les risques futurs liés à la fonte de l'Antarctique et à l'élévation du niveau des mers, des enjeux majeurs pour les communautés côtières du monde entier.