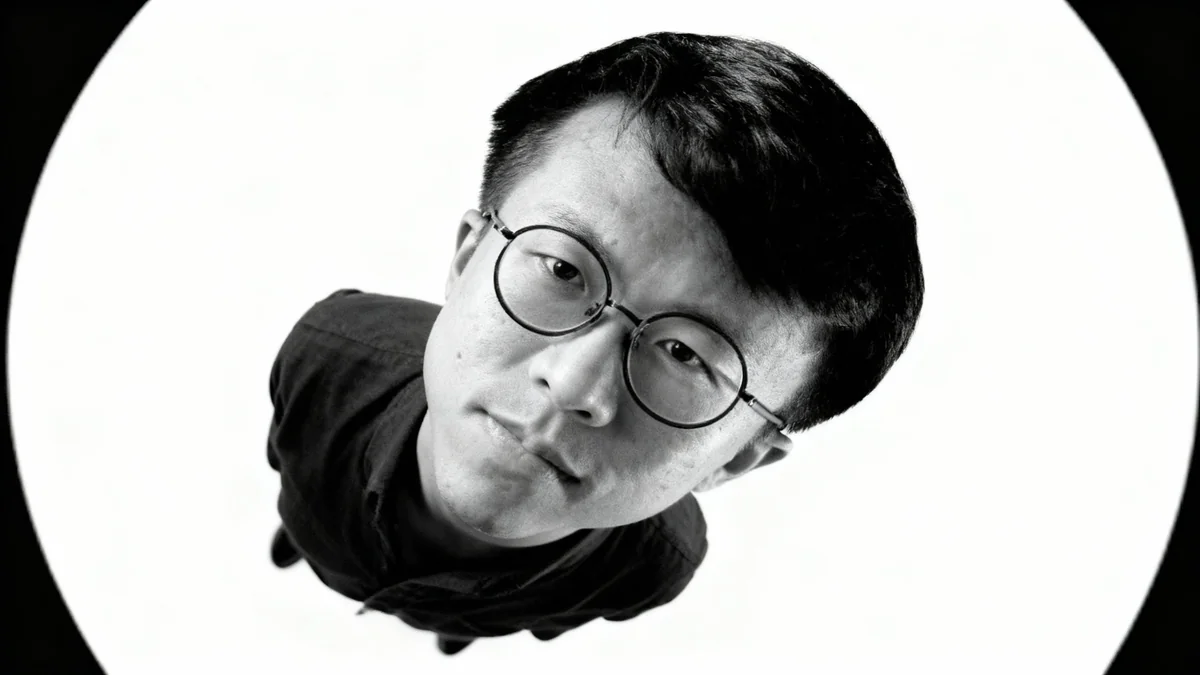Une équipe internationale de chercheurs, menée par l'Institut Max Planck de chimie, a identifié le mécanisme principal derrière les proliférations massives de sargasses dans l'océan Atlantique. Cette avancée permet de mieux comprendre ce phénomène qui menace les côtes caraïbéennes et de développer des systèmes de prédiction pour les futurs échouages.
Points Clés
- Le phosphore provenant des eaux profondes équatoriales est le principal moteur des proliférations.
- Les cyanobactéries fixent l'azote atmosphérique, offrant un avantage compétitif aux sargasses.
- L'analyse des carottes de corail a révélé l'historique de la fixation d'azote sur 120 ans.
- Le mécanisme est lié aux températures de surface de la mer et aux anomalies éoliennes.
- De nouvelles prédictions plus précises sont désormais possibles.
Un record alarmant et une énigme résolue
En juin dernier, environ 38 millions de tonnes de sargasses ont dérivé vers les Caraïbes, le golfe du Mexique et le nord de l'Amérique du Sud, marquant un record. Ces algues brunes, en se décomposant sur les plages, dégagent une odeur nauséabonde. Elles repoussent les touristes et menacent les écosystèmes côtiers. En pleine mer, les sargasses flottantes sont un habitat et une source de nourriture pour de nombreuses espèces marines.
Depuis 2011, les scientifiques observent la « Grande Ceinture Atlantique de Sargasses », un immense tapis d'algues dérivant de l'équateur vers les Caraïbes sous l'effet des vents d'est. Jusqu'à présent, l'origine des nutriments, comme le phosphore et l'azote, qui alimentent leur croissance rapide restait floue. Des hypothèses incluaient le ruissellement de nutriments lié à la surfertilisation et à la déforestation. Cependant, ces explications ne suffisaient pas à rendre compte de l'augmentation observée.
Chiffre clé
En juin, 38 millions de tonnes de sargasses ont été enregistrées dans l'Atlantique, un record négatif.
Le rôle crucial du phosphore et des cyanobactéries
Les chercheurs expliquent que de forts courants ascendants, générés par le vent près de l'équateur, transportent le phosphore vers la surface de l'océan. Ce phosphore est ensuite déplacé vers le nord, atteignant les Caraïbes. Cette augmentation de la disponibilité en phosphore favorise les cyanobactéries qui se développent sur les algues brunes.
Ces bactéries ont la capacité de capter l'azote gazeux de l'atmosphère et de le transformer en une forme utilisable par les algues, un processus appelé fixation de l'azote. Cette relation symbiotique offre aux sargasses un avantage compétitif par rapport aux autres algues de l'Atlantique équatorial. Elle explique les changements passés dans la biomasse de sargasses.
« Dans la première série de mesures, nous avons remarqué deux augmentations significatives de la fixation de l'azote en 2015 et 2018, deux années de proliférations record de sargasses. » explique Jonathan Jung, doctorant à l'Institut Max Planck de chimie et premier auteur de l'étude.
Les coraux, archives des océans
Pour établir ce lien, les scientifiques ont analysé des carottes de corail provenant de diverses régions des Caraïbes. Les coraux sont des archives naturelles précieuses. En grandissant, ils incorporent les signatures chimiques de l'eau dans leurs squelettes calcaires. L'analyse des couches de croissance annuelles des coraux permet de reconstituer les changements de composition chimique de l'océan sur des siècles.
Les chercheurs ont mesuré la composition isotopique de l'azote dans ces coraux pour reconstruire la quantité d'azote fixée par les micro-organismes marins au cours des 120 dernières années. La fixation d'azote par les bactéries modifie le rapport des isotopes stables de l'azote 15N et 14N dans l'océan. Des périodes de faible rapport 15N/14N dans les couches de corail indiquent des taux élevés de fixation d'azote.
Qu'est-ce que la fixation d'azote?
La fixation d'azote est un processus par lequel l'azote gazeux de l'atmosphère est converti en ammoniac ou en d'autres composés azotés utilisables par les organismes vivants. Les cyanobactéries sont des acteurs clés de ce processus dans les écosystèmes marins, enrichissant l'eau en nutriments essentiels.
Couplage entre croissance des algues et fixation d'azote
Depuis 2011, la croissance des algues et la fixation d'azote sont étroitement liées. Jonathan Jung a noté que les valeurs maximales et minimales des données sur la croissance des algues et la fixation d'azote sont parfaitement alignées depuis cette année-là. Ce couplage est significatif car en 2010, de forts vents ont déplacé pour la première fois les sargasses de la mer des Sargasses vers l'Atlantique tropical.
L'équipe de recherche a écarté d'autres théories. Par exemple, l'apport de poussière saharienne riche en fer, souvent transportée de l'Afrique vers l'Atlantique, ne correspondait pas à la biomasse des sargasses. De même, les apports de nutriments des fleuves Amazone ou Orénoque n'ont pas montré de corrélation avec les observations des proliférations.
Chronologie
Depuis 2011, la croissance des sargasses et la fixation d'azote sont systématiquement couplées.
Améliorer les prévisions futures
Le nouveau mécanisme décrit par les chercheurs met en évidence le phosphore des eaux profondes et l'azote de la fixation comme les moteurs des proliférations observées ces dernières décennies. « Notre mécanisme explique la variabilité de la croissance des sargasses mieux que toutes les approches précédentes », affirme Jonathan Jung. Il précise toutefois qu'il existe encore des incertitudes quant au rôle d'autres facteurs.
L'approvisionnement en phosphore est influencé par des températures de surface de la mer plus froides dans l'Atlantique Nord tropical et plus chaudes dans l'Atlantique Sud. Ces variations de température entraînent des changements de pression atmosphérique, provoquant des anomalies éoliennes qui déplacent l'eau de surface et permettent aux eaux profondes riches en phosphore de remonter.
Observer les vents, les températures de la mer et les changements de courants ascendants dans l'Atlantique équatorial peut donc améliorer les prévisions de croissance des sargasses. Alfredo Martínez-García, chef de groupe à l'Institut Max Planck de chimie et auteur principal de l'étude, souligne que l'avenir des sargasses dans l'Atlantique tropical dépendra de la manière dont le réchauffement climatique affectera les processus d'approvisionnement en phosphore.
Son équipe prévoit de recueillir de nouvelles données coralliennes à différents endroits des Caraïbes pour affiner cette compréhension. Ces découvertes pourraient aider à atténuer les impacts des proliférations sur les écosystèmes récifaux et les communautés côtières des Caraïbes.