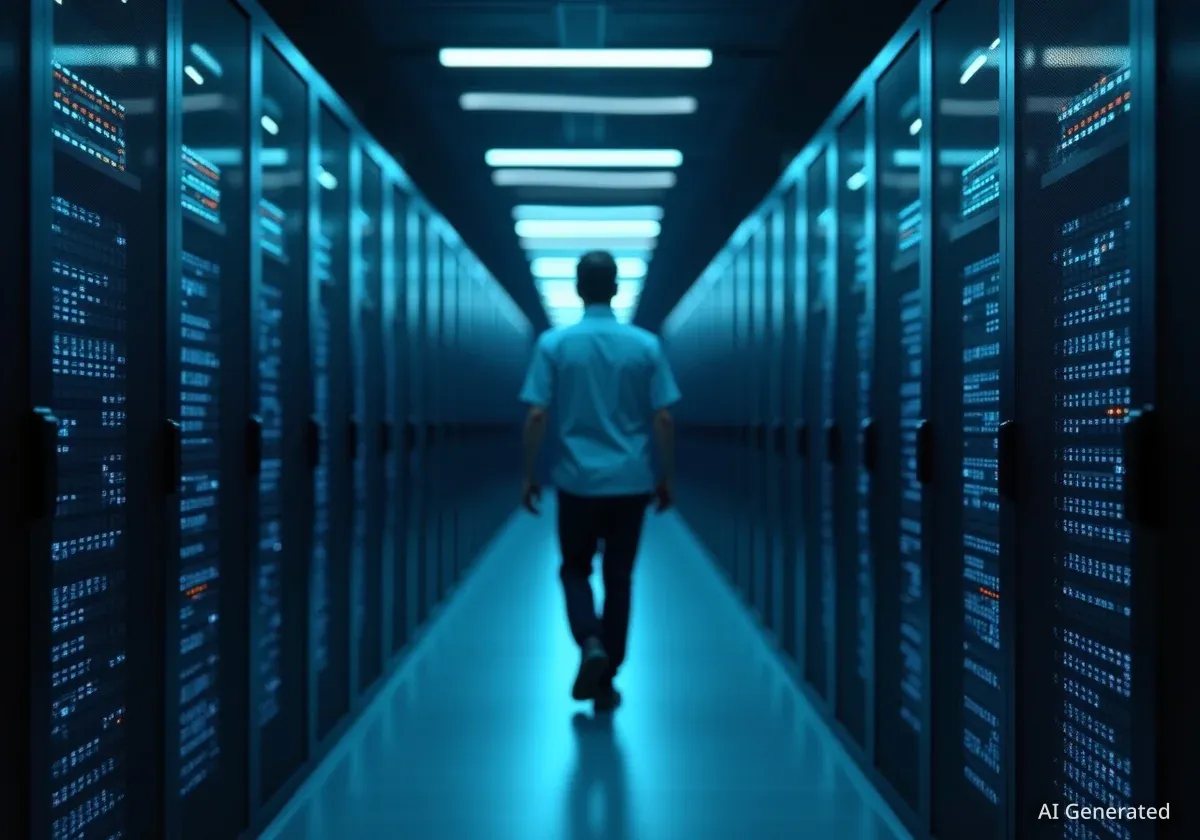Les programmes de lutte contre le changement climatique financés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada représentent un investissement total de 503 milliards de dollars. Ce montant, réparti sur l'ensemble de la population, équivaut à une dépense de 12 062 $ pour chaque Canadien, selon une compilation de données gouvernementales et d'analyses économiques.
Cette somme colossale couvre des centaines d'initiatives lancées au cours de la dernière décennie, mais des questions subsistent quant à leur efficacité et à leur impact économique à long terme, alors que le pays peine à atteindre ses objectifs de réduction des émissions.
Points Clés
- Le coût combiné des programmes climatiques fédéraux et provinciaux s'élève à 503 milliards de dollars.
- Cela représente une charge financière de 12 062 $ par citoyen canadien.
- Des études estiment que les politiques climatiques pourraient réduire le revenu annuel des travailleurs de plusieurs milliers de dollars d'ici 2050.
- Le Canada n'est pas en voie d'atteindre son objectif de réduction des émissions pour 2030.
Un fardeau financier de 503 milliards de dollars
Le calcul de ce coût massif combine les dépenses de plusieurs niveaux de gouvernement. Le gouvernement fédéral a engagé à lui seul plus de 200 milliards de dollars dans 149 programmes différents depuis 2015, comme l'a indiqué l'ancien ministre de l'Environnement Steven Guilbeault en avril 2023.
Ces initiatives sont gérées par 13 ministères fédéraux distincts, ce qui illustre l'ampleur de l'effort gouvernemental pour la transition énergétique.
À cela s'ajoutent les dépenses des provinces et des territoires. Une analyse basée sur les données de l'Institut climatique du Canada et de Navius Research estime que les gouvernements provinciaux ont alloué environ 303 milliards de dollars à 364 programmes climatiques distincts.
Ventilation des coûts
Dépenses fédérales : > 200 milliards de dollars
Dépenses provinciales/territoriales : 303 milliards de dollars
Total : 503 milliards de dollars
Coût par Canadien : 12 062 $
Il est important de noter que ces chiffres représentent uniquement le coût direct du financement des programmes gouvernementaux. Ils n'incluent pas les coûts indirects supportés par les entreprises et les consommateurs pour se conformer aux nouvelles réglementations.
L'impact sur l'économie et les travailleurs canadiens
Au-delà des dépenses publiques, des économistes s'inquiètent de l'impact des politiques climatiques sur la santé économique globale du pays. Une étude de l'Institut Fraser, menée par l'économiste Ross McKitrick de l'Université de Guelph, a modélisé les conséquences potentielles de l'atteinte de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050.
Selon ses conclusions, la transition pourrait entraîner une réduction du PIB canadien de 6,2 % en 2050. Pour un travailleur moyen, cela se traduirait par une perte de revenu annuel de 8 000 $. L'étude prévoit également la perte de 254 000 emplois.
Même l'objectif intermédiaire pour 2030, qui vise une réduction des émissions de 40 % par rapport aux niveaux de 2005, aurait un coût significatif. Le même économiste estime que cet objectif pourrait coûter 6 700 $ par an au travailleur canadien moyen.
Changement de cap du gouvernement
Le gouvernement du premier ministre Mark Carney a récemment annulé la taxe carbone pour les consommateurs, signalant un changement de stratégie. Une nouvelle « stratégie de compétitivité climatique », axée sur une taxe carbone industrielle élargie, doit être dévoilée prochainement. Bien que l'objectif de 2050 soit maintenu, l'engagement envers la cible de 2030, fixée par l'administration précédente, a été abandonné.
Des objectifs de réduction difficiles à atteindre
Malgré les investissements massifs, le Canada est loin d'être sur la bonne voie pour atteindre ses cibles climatiques. En 2023, les émissions du pays n'étaient que de 8,5 % inférieures à celles de 2005, bien loin de l'objectif de 40 % fixé pour 2030.
Deux organismes de surveillance majeurs, l'Institut climatique du Canada et l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal, ont récemment conclu que l'objectif de 2030 est désormais inaccessible. Ils estiment que le Canada ne parviendra à réduire ses émissions que de moitié par rapport à la cible, soit environ 20 %.
« Les données montrent clairement un écart important entre les ambitions affichées et les résultats obtenus. Atteindre la cible de 2030 nécessiterait des mesures beaucoup plus drastiques et rapides que celles actuellement en place. »
Pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, les investissements devront encore s'accélérer. En 2021, RBC a estimé que le coût total de cette transition s'élèverait à environ 2 000 milliards de dollars sur trois décennies, nécessitant des investissements annuels d'au moins 60 milliards de dollars de la part des gouvernements et du secteur privé.
Le Canada dans le contexte mondial
L'un des arguments soulevés dans le débat est la faible contribution du Canada aux émissions mondiales. Avec environ 1,4 % du total mondial, les efforts du pays, aussi coûteux soient-ils, ont un impact limité sur le climat global sans une action concertée à l'échelle internationale.
Le directeur parlementaire du budget a d'ailleurs souligné en 2024 que les réductions d'émissions du Canada « ne sont pas assez importantes pour avoir un impact matériel sur le changement climatique » à elles seules.
Pendant ce temps, les émissions mondiales continuent d'augmenter. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie ont atteint un record de 37,8 milliards de tonnes en 2024. Un rapport des Nations Unies estime que la trajectoire actuelle ne permettra qu'une baisse de 17 % des émissions mondiales d'ici 2035, loin de l'objectif de 60 % jugé nécessaire.
Les partisans des politiques climatiques actuelles soutiennent que ces analyses ne tiennent pas compte des coûts de l'inaction, comme les dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes, ni des opportunités économiques créées par les technologies vertes. Cependant, le débat sur le juste équilibre entre ambition écologique et viabilité économique reste plus pertinent que jamais pour les Canadiens.