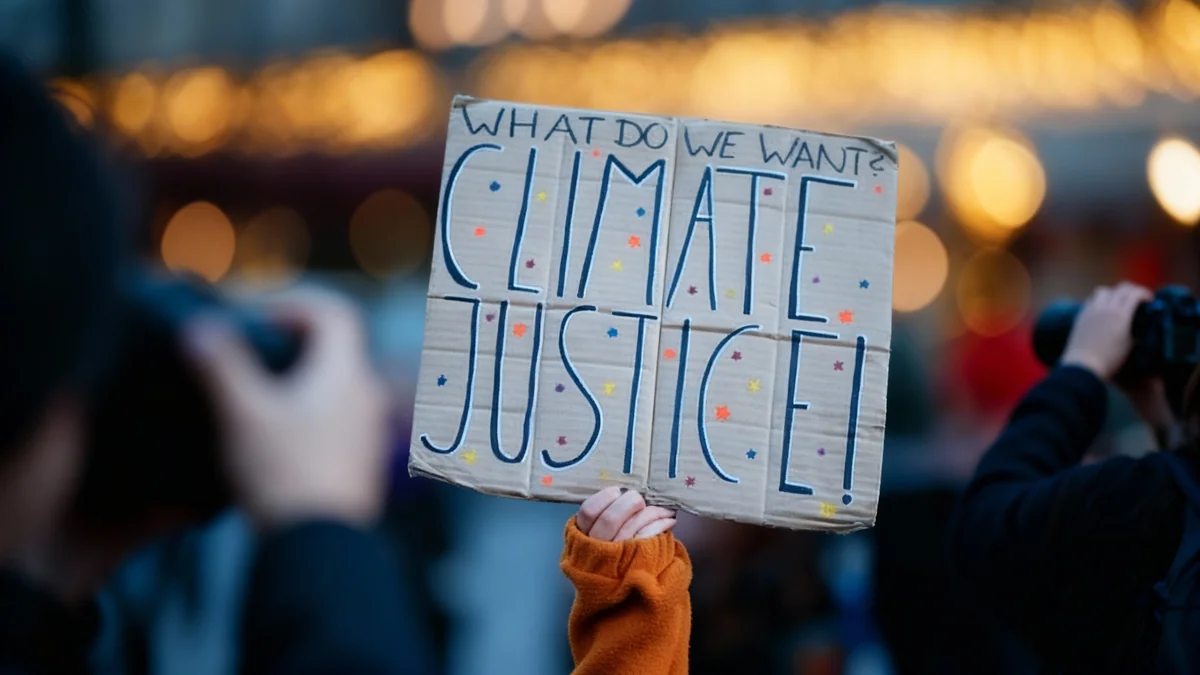En juillet 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu un avis consultatif historique sur les obligations des États face au changement climatique. Si cette décision reconnaît le droit à un environnement sain comme une condition des droits humains, elle laisse en suspens une question cruciale : les peuples et les individus sont-ils directement titulaires de ces droits face aux États ?
L'avis se concentre sur la capacité des individus à porter plainte, sans clarifier s'ils sont les créanciers directs des obligations environnementales des États. Cette distinction est fondamentale, car elle détermine la portée juridique de la responsabilité des nations envers leurs citoyens et l'humanité dans son ensemble.
Points Clés
- La CIJ a affirmé que la protection de l'environnement est essentielle à la jouissance des droits humains.
- L'avis n'a pas explicitement reconnu les individus et les peuples comme créanciers directs des obligations climatiques des États.
- La Cour s'est principalement limitée à la question de la qualité pour agir (la capacité de saisir la justice), laissant de côté la question de la titularité des droits.
- Des experts estiment que cette approche conservatrice limite les conséquences juridiques pour les États responsables de violations climatiques.
- La question de savoir si ces obligations s'appliquent erga omnes (à l'égard de tous), y compris envers tous les peuples et individus, reste ouverte.
Le statut juridique des peuples et des individus
L'une des principales interrogations soulevées par l'avis de la CIJ concerne le statut des "peuples et individus". La Cour n'a pas clairement établi s'ils sont des créanciers directs des obligations des États en matière de droits humains liés au climat. Elle a plutôt abordé la question sous l'angle procédural.
Selon le paragraphe 111 de l'avis, la capacité des individus à invoquer la responsabilité d'un État dépend des traités spécifiques qui créent des droits entre les États et les personnes concernées. Cette approche est jugée restrictive par certains analystes, car elle fusionne deux concepts distincts : l'existence d'un droit et la capacité de le faire valoir en justice.
Avant de déterminer qui peut porter plainte, il est essentiel de savoir à qui l'obligation est due. Les individus et les peuples sont-ils de simples bénéficiaires des politiques climatiques ou sont-ils de véritables titulaires de droits, c'est-à-dire des créanciers ?
Une distinction fondamentale
La juge Sebutinde, dans son opinion, a souligné cette lacune. Elle a noté que les obligations des États pollueurs ne sont pas seulement dues à d'autres États, mais aussi directement "aux peuples et aux individus des générations présentes et futures".
En se concentrant uniquement sur la capacité procédurale des individus, la Cour a ignoré la question de fond de savoir si ces individus (ainsi que les peuples) détiennent les droits substantiels en question.
En droit international des droits de l'homme, la relation est généralement verticale : elle lie directement l'État aux individus. Des textes fondamentaux comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) affirment que les droits appartiennent à "toute personne". Ne pas appliquer ce principe aux obligations climatiques créerait une incohérence majeure.
Les conséquences juridiques d'une reconnaissance
Reconnaître les peuples et les individus comme créanciers directs des obligations climatiques aurait des implications juridiques importantes, même sans leur accorder une capacité universelle à saisir la justice.
Premièrement, cela clarifierait la nature des obligations des États. Il ne s'agirait plus seulement de devoirs entre nations, mais d'obligations verticales envers les sujets de droit international. Une violation serait alors une faute non seulement envers un autre État, mais aussi envers les porteurs mêmes des droits.
Deuxièmement, cette reconnaissance influencerait l'interprétation des lois. Les tribunaux et autres organes internationaux tendent à interpréter les obligations de manière à assurer une protection pratique et efficace des titulaires de droits. Cela favoriserait des lectures plus larges des devoirs des États.
Interprétation et protection
Une approche centrée sur les titulaires de droits encouragerait la reconnaissance d'obligations positives de prévention, l'application du principe de précaution en cas d'incertitude scientifique, et une vision moins restrictive de la juridiction ou de la causalité pour éviter de laisser les victimes sans protection.
Enfin, cela préparerait le terrain pour une évolution du droit international. Bien que les règles actuelles limitent souvent l'accès des individus à la justice internationale, reconnaître leur statut de créanciers pourrait stimuler la création de nouveaux mécanismes de plainte, qu'ils soient collectifs ou individuels.
La dimension erga omnes des obligations climatiques
L'avis de la CIJ a introduit une notion puissante en qualifiant les obligations des États relatives à la protection du climat d'obligations erga omnes (dues à la communauté internationale dans son ensemble) et erga omnes partes (dues à toutes les parties d'un traité).
Cependant, la Cour est restée silencieuse sur la question de savoir si les obligations en matière de droits humains liées au climat partagent ce même caractère. Elle a fondé son raisonnement sur "l'intérêt commun des États pour la protection des biens environnementaux mondiaux" plutôt que sur les droits fondamentaux de la personne humaine, une approche plus prudente.
Qui sont les "tous" ?
Si ces obligations de droits humains sont bien erga omnes, une autre question se pose : le terme "omnes" (tous) inclut-il uniquement les États, ou également l'ensemble des peuples et des individus ?
L'argument est que si tous les États ont un intérêt juridique à ce que les droits humains soient respectés partout, et si chaque individu est titulaire de ces droits, alors tous les individus collectivement devraient être considérés comme les créanciers de ces obligations.
La jurisprudence antérieure de la CIJ soutient cette idée. Dans l'affaire Barcelona Traction, la Cour a lié les normes erga omnes aux "droits fondamentaux de la personne humaine". Dans l'affaire du Timor oriental, elle a parlé de "droits erga omnes", suggérant que les titulaires ne sont pas seulement les États.
La limite de l'actio popularis
Actuellement, le droit international n'autorise généralement pas l'actio popularis, c'est-à-dire une action en justice d'intérêt public où un individu agit au nom de tous. Les cours régionales des droits de l'homme, comme la Cour européenne des droits de l'homme, exigent que le plaignant soit une "victime" personnellement et directement affectée. Cela signifie que même si une obligation est due à tous, seuls ceux qui subissent un préjudice direct peuvent agir.
Vers une nouvelle ère du contentieux climatique ?
Malgré les limites procédurales actuelles, reconnaître que les obligations climatiques sont dues à l'ensemble des peuples et individus aurait des conséquences significatives. Cela pourrait inciter les juridictions nationales et internationales à réviser leurs règles de procédure.
Par exemple, des mécanismes pourraient être créés pour permettre à des non-victimes d'agir pour demander la cessation d'une violation ou des réparations pour les personnes lésées. Même sans réforme institutionnelle, cette reconnaissance pourrait amener les juges à interpréter plus largement les critères de "victime" ou "victime potentielle".
L'avis de la CIJ de 2025, bien que conservateur sur certains points, ouvre la porte à des développements doctrinaux majeurs. La question fondamentale reste de savoir si le droit international évoluera pour combler le fossé entre la reconnaissance des droits des individus et leur capacité à les défendre activement sur la scène mondiale.
La clarification de ce statut est essentielle pour définir les contours de la responsabilité des États et façonner l'avenir du contentieux climatique, où les peuples et les individus cherchent de plus en plus à tenir les gouvernements responsables de leur action ou de leur inaction face à l'urgence environnementale.