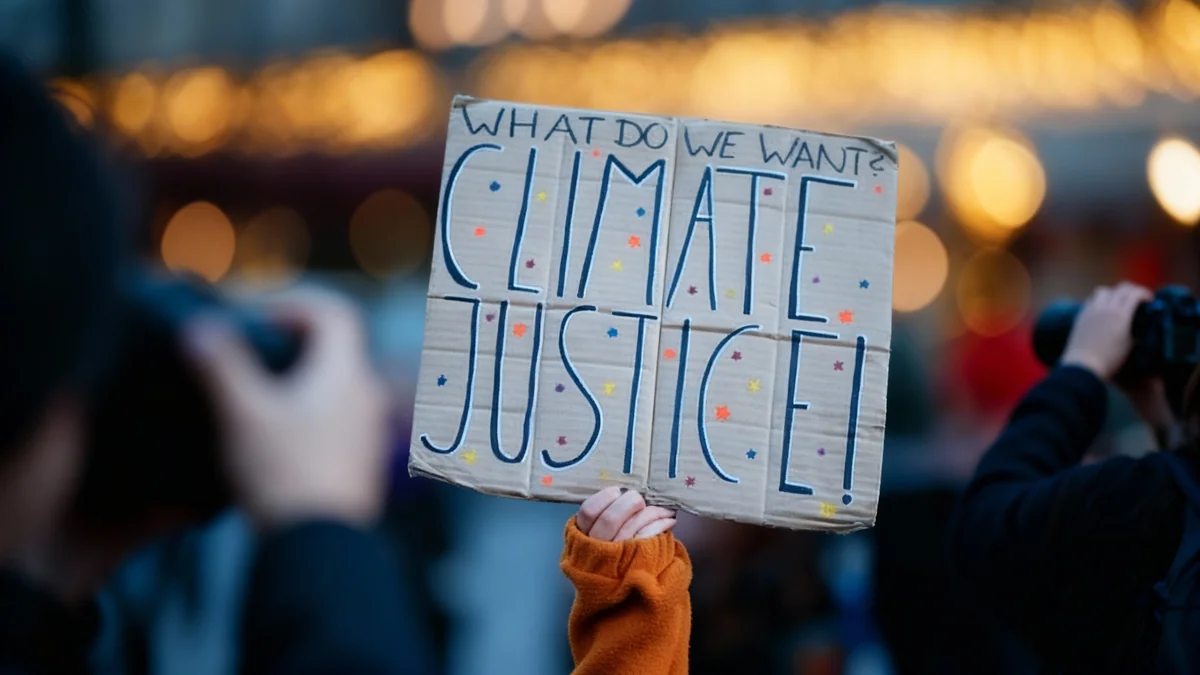Une nouvelle étude révèle une profonde injustice climatique : les dix nations qui subiront la plus forte augmentation de jours de chaleur dangereuse sont celles qui contribuent le moins au réchauffement planétaire. Ces pays, principalement de petites nations insulaires, ne sont responsables que de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre mais en paient le prix le plus élevé.
Le rapport, mené par World Weather Attribution et Climate Central, quantifie l'impact direct du changement climatique sur l'exposition à des températures extrêmes, soulignant l'urgence d'une action climatique équitable.
Points Clés
- Les 10 pays les plus touchés par les jours de chaleur extrême ne produisent que 1 % des émissions mondiales.
- L'Accord de Paris a permis de réduire de moitié le nombre de jours de chaleur extrême prévus, mais la trajectoire actuelle reste dangereuse.
- Les plus grands pollueurs mondiaux (États-Unis, Chine, Inde) connaîtront une augmentation bien moindre des jours de forte chaleur.
- Cette "inégalité thermique" risque d'aggraver les tensions géopolitiques entre les nations riches et pauvres.
Une augmentation alarmante des températures extrêmes
Une étude récente a calculé l'augmentation des "super-journées chaudes", définies comme des jours où la température dépasse 90 % des températures enregistrées pour la même période entre 1991 et 2020. Bien que non encore évalué par des pairs, le rapport utilise des méthodes d'attribution climatique reconnues.
L'analyse met en lumière l'importance de l'Accord de Paris de 2015. Avant cet accord, le monde se dirigeait vers un réchauffement catastrophique de 4°C d'ici la fin du siècle. Ce scénario aurait entraîné 114 jours de chaleur extrême supplémentaires par an.
L'impact de l'Accord de Paris
Grâce aux engagements actuels, la trajectoire du réchauffement a été ramenée à 2,6°C. Dans ce scénario, la planète connaîtra tout de même 57 jours de chaleur extrême supplémentaires par an d'ici 2100, soit près de deux mois de températures dangereuses. C'est cependant une réduction de 50 % par rapport au scénario du pire.
Depuis 2015, le monde a déjà connu en moyenne 11 jours de chaleur extrême supplémentaires par an, montrant que les effets du changement climatique sont déjà bien présents.
Une fracture climatique mondiale
Le rapport souligne une déconnexion massive entre les responsables de la pollution carbone et ceux qui en subissent les conséquences les plus graves. Les dix pays qui devraient connaître la plus forte augmentation de jours de chaleur dangereuse sont presque tous de petites nations dépendantes de l'océan.
Les nations les plus vulnérables
Parmi les pays les plus touchés, on trouve :
- Panama
- Les Îles Salomon
- Samoa
Ces nations, ainsi que d'autres dans une situation similaire, verront leur nombre de jours de chaleur extrême augmenter de manière spectaculaire. Le Panama, par exemple, pourrait faire face à 149 jours de chaleur extrême supplémentaires par an.
Faibles émetteurs, lourdes conséquences
Collectivement, ces dix pays les plus menacés ne sont responsables que de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette statistique met en évidence une profonde injustice au cœur de la crise climatique.
En revanche, les plus grands émetteurs de carbone au monde, comme les États-Unis, la Chine et l'Inde, ne devraient subir qu'entre 23 et 30 jours de chaleur extrême supplémentaires. Ensemble, ils sont responsables de 42 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, mais ne subiront que moins de 1 % des jours de chaleur extrême additionnels.
Des conséquences humaines et géopolitiques
Bien que le rapport ne chiffre pas précisément le nombre de personnes qui seront affectées, les experts s'accordent sur l'ampleur de l'impact humain. Les vagues de chaleur tuent déjà des milliers de personnes chaque année, et cette tendance devrait s'aggraver.
"Il s'agira certainement de dizaines de milliers ou de millions, pas moins", a déclaré Friederike Otto de l'Imperial College London, co-auteure de l'étude, concernant le nombre de personnes qui seront touchées.
Johan Rockström, directeur de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur le climat, qui n'a pas participé à l'étude, a averti que même la trajectoire actuelle de 2,6°C "impliquerait toujours un avenir désastreux pour des milliards d'êtres humains sur Terre".
Risques d'instabilité mondiale
Cette "inégalité thermique" a également des implications géopolitiques. Andrew Weaver, climatologue à l'Université de Victoria, a souligné que cette situation "creuse un fossé supplémentaire entre les nations riches et pauvres".
Selon lui, cette disparité croissante pourrait semer les graines de l'instabilité géopolitique, alors que les pays les moins responsables de la crise sont laissés pour compte face à ses pires conséquences. L'injustice climatique devient ainsi un facteur de risque pour la sécurité et la stabilité mondiales.