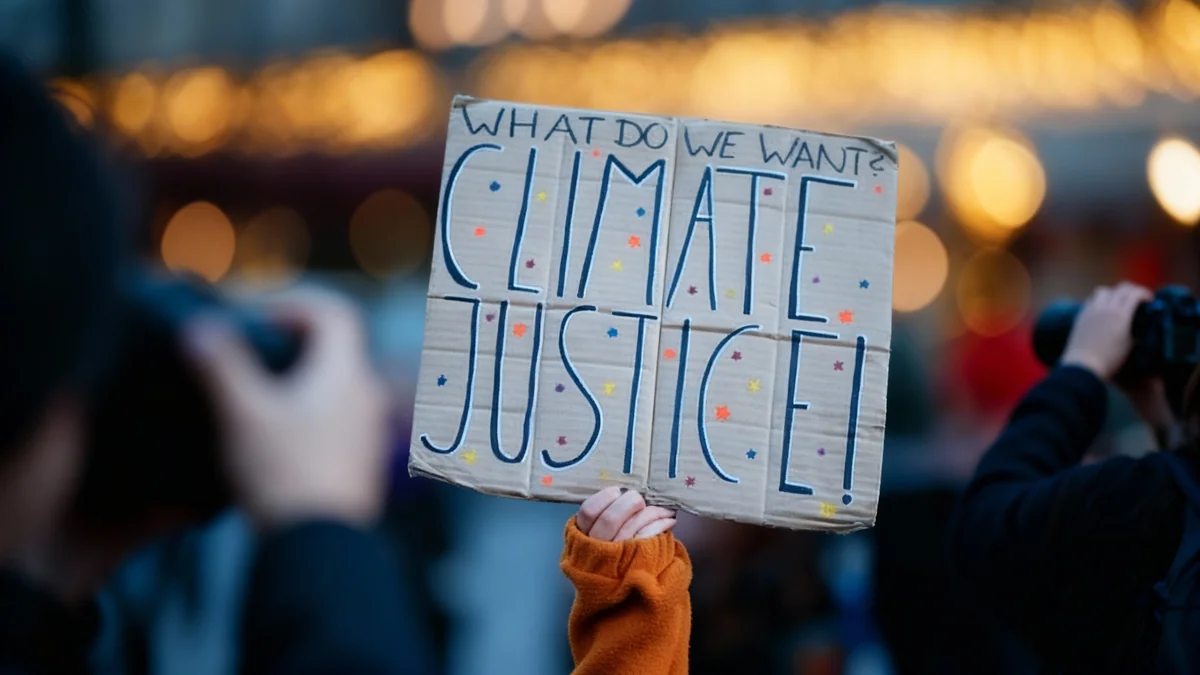Des dizaines de milliers de migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis proviennent de régions dévastées par des catastrophes climatiques répétées. Une enquête révèle comment les ouragans, les inondations et les sécheresses au Guatemala, au Sénégal et au Bangladesh poussent des familles entières à entreprendre un périlleux voyage vers une nouvelle vie, souvent à New York.
Points Clés
- Des milliers de migrants arrivés à New York depuis 2022 fuient des zones touchées par des catastrophes climatiques récurrentes.
- Une analyse de données montre une corrélation entre les migrations et les zones subissant des ouragans, inondations et sécheresses répétés.
- Le Guatemala, le Sénégal et le Bangladesh sont parmi les pays où ce phénomène est le plus visible.
- Les migrants ne citent pas directement le "changement climatique", mais décrivent ses conséquences : récoltes détruites, maisons inondées et moyens de subsistance perdus.
- Le statut de "réfugié climatique" n'étant pas reconnu, ces personnes se retrouvent dans une situation d'incertitude juridique aux États-Unis.
Des vies bouleversées par l'eau et la sécheresse
Dans une mosquée du Bronx, Mohamed* raconte son histoire. Assis en tailleur sur le tapis, il se souvient de ses champs de maïs, de pastèques et d'arachides à Diourbel, au Sénégal. Cette terre, héritée de son grand-père, est devenue "pratiquement inutile" après des années d'alternance imprévisible entre inondations et sécheresses.
"Quand il pleuvait, tout le monde était pris par surprise, car pendant très longtemps nous n'avions pas eu de pluie, il y avait la sécheresse", explique cet homme de 45 ans. Il fait partie d'un nombre croissant de migrants d'Afrique de l'Ouest qui ont traversé la frontière américano-mexicaine pour s'installer à New York.
Son témoignage n'est pas un cas isolé. Une enquête menée sur plus de neuf millions de dossiers d'arrestations à la frontière entre 2010 et 2024 révèle une tendance claire. Des dizaines de milliers de migrants viennent de localités frappées de manière répétée par des catastrophes naturelles extrêmes.
L'analyse des données migratoires
L'étude a croisé les données des services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), qui incluent les lieux de naissance des migrants, avec une base de données internationale sur les catastrophes naturelles majeures (EM-DAT). Les résultats montrent que plus de 55 pays ayant connu des taux de migration externe supérieurs à la moyenne ont également été dévastés par trois catastrophes climatiques ou plus entre 2019 et 2024.
Ces événements climatiques extrêmes ne sont souvent pas la seule raison du départ, mais ils agissent comme un facteur aggravant, un point de rupture pour des économies déjà fragiles et des familles en difficulté.
Le Guatemala : fuir les tempêtes et les sols arides
Gricelda* a pris sa décision en 2018. Pendant des années, elle a lutté contre les infiltrations d'eau dans sa maison en pisé près de Quetzaltenango, dans les hauts plateaux de l'ouest du Guatemala. Les pluies torrentielles, comme celles de la tempête tropicale Agatha en 2010, affaiblissaient les murs de sa maison année après année.
"Il y avait beaucoup d'inondations. La pluie était très, très forte", se souvient-elle dans un café de East Harlem. Mais le problème était double. Les périodes de pluies intenses étaient ponctuées de sécheresses prolongées qui asséchaient les terres agricoles.
"Si la pluie arrive trop tard, la récolte ne poussera peut-être pas comme elle le devrait. Elle ne donnera peut-être pas 100 %, mais 50 %. Et comme la saison est terminée, c'est déjà une perte pour l'année."
La vie de sa famille, centrée sur la récolte de maïs, de haricots et de pommes de terre, est devenue de plus en plus précaire. L'accès à l'eau potable était également un défi constant. "Il n'y avait plus beaucoup de pluie, et quand les tempêtes frappaient, elles rendaient la rivière sale", explique-t-elle.
Migration guatémaltèque
Entre 2019 et 2024, bien que la migration globale depuis le Guatemala ait diminué, la part des migrants venant de la région des hauts plateaux de l'ouest, comme Quetzaltenango, a légèrement augmenté. Cette région a subi au moins sept cyclones, inondations et ouragans majeurs depuis 2010.
En 2013, son mari est parti pour New York. Cinq ans plus tard, Gricelda l'a suivi avec ses enfants, après avoir contracté un prêt en utilisant la terre de son père comme garantie. Aujourd'hui, elle vit à East Harlem, mais son avenir est incertain. Une tentative de demande d'asile s'est soldée par une escroquerie, et elle hésite à faire de nouveau confiance au système.
Du Sénégal à New York : un espoir né du désespoir
Pour Mohamed, au Sénégal, les inondations à Diourbel signifiaient que l'eau stagnait pendant des mois sur ses terres, devenant un foyer pour les moustiques. Il a dû construire un chemin en briques pour que sa famille puisse entrer dans la maison sans se mouiller. Ses tentatives de s'adapter en changeant de culture, passant de l'arachide au maïs, ont échoué. Les plants ont tous dépéri.
Les difficultés économiques ont exacerbé les tensions familiales. Son frère, enseignant avec un meilleur revenu, a pu construire une maison surélevée pour se protéger des inondations. Mohamed, lui, devait écoper l'eau de sa propre maison, une situation qui a conduit à l'humiliation de ses enfants à l'école.
C'est à la télévision et sur les réseaux sociaux qu'il a vu une autre vie possible. Des vidéos sur TikTok et Instagram, souvent publiées par des passeurs se faisant passer pour des agents de voyage, promettaient un accès facile à des permis de travail et à des emplois aux États-Unis.
"On m'a dit qu'une fois arrivé aux États-Unis, tout le monde est égal devant la loi. Personne ne peut vous expulser", raconte Mohamed. En octobre 2023, il a vendu ses biens et emprunté de l'argent pour payer plus de 10 000 dollars son voyage.
La dure réalité de l'exil
La réalité à New York était bien différente des vidéos promotionnelles. Il a d'abord séjourné dans un refuge pour migrants près de Times Square, mais a été expulsé après un mois. Il s'est retrouvé à dormir dans le métro, où il a rencontré d'autres Sénégalais dans la même situation.
Ils se sont entraidés, s'appuyant sur les réseaux communautaires et religieux. La mosquée du Bronx, dirigée par un imam originaire de la même région du Sénégal, est devenue un point de ralliement. Là, il a trouvé du réconfort et partagé ses expériences avec d'autres agriculteurs déracinés.
Aujourd'hui, ces communautés s'organisent via des groupes WhatsApp pour échanger des informations sur les emplois, les logements et les démarches administratives. Mais la menace d'expulsion plane, rendant leur avenir encore plus précaire.
Un vide juridique face à une crise croissante
Le principal défi pour ces migrants est que le droit international et américain ne reconnaît pas clairement le statut de réfugié pour les personnes fuyant les catastrophes climatiques. Leurs demandes d'asile, basées sur la perte de leurs moyens de subsistance due aux inondations ou à la sécheresse, ont peu de chances d'aboutir.
"Ce n'est pas simplement qu'un ouragan s'est produit", explique Felipe Navarro, du Center for Gender and Refugee Studies. "C'est que l'ouragan a causé des ravages, et c'est la manière dont l'État a réagi qui compte." L'incapacité des gouvernements à protéger et à soutenir leurs citoyens après de telles catastrophes peut devenir un facteur clé dans la décision de migrer.
Alors que les événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses, le nombre de personnes déplacées par le climat devrait augmenter. Pour des milliers de personnes comme Mohamed et Gricelda, le voyage vers les États-Unis n'était pas un choix, mais une nécessité pour survivre. Pourtant, arrivés à destination, ils font face à un nouveau combat : celui de la reconnaissance et de la stabilité dans un pays qui n'est pas encore prêt à accueillir les réfugiés de la crise climatique.
*Certains noms ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes en raison de leur statut migratoire.