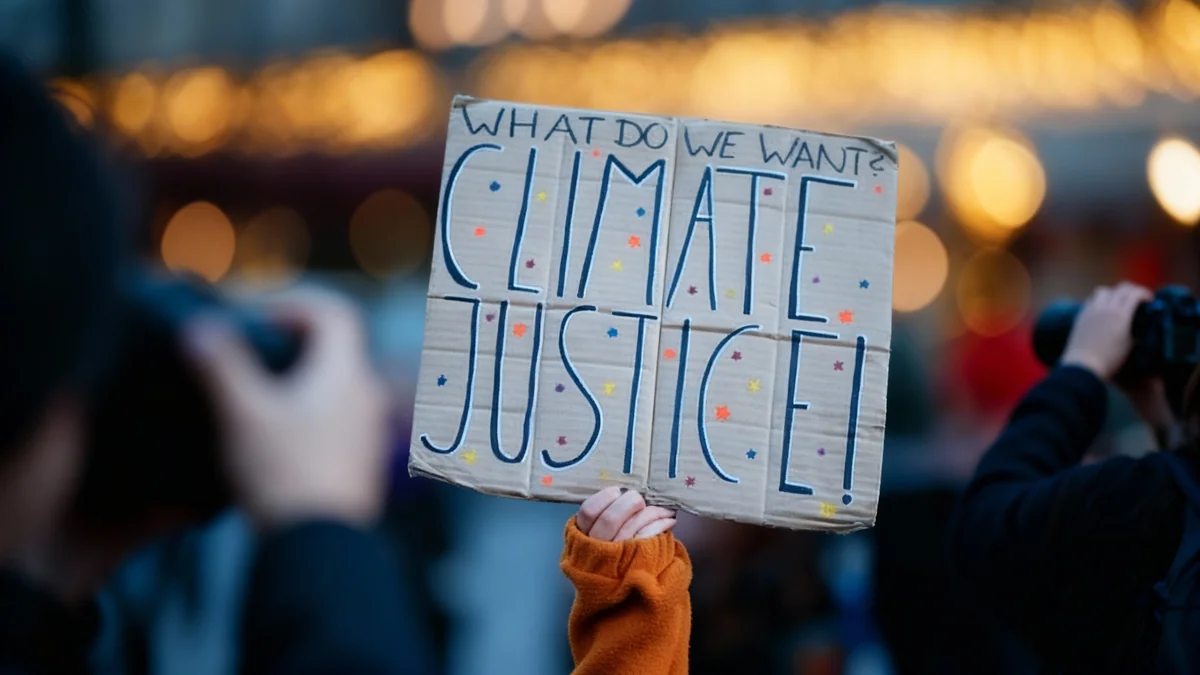Le 7 octobre, un réseau de plus de 900 législateurs a présenté les conclusions d'une enquête parlementaire sur l'élimination progressive des combustibles fossiles en Amazonie. Ce rapport, dévoilé au Congrès National Brésilien à Brasília, met en lumière les liens directs entre l'extraction de combustibles fossiles et la déforestation, la fragmentation des écosystèmes, la pollution, les déplacements de communautés, les problèmes de santé et la violence des groupes armés dans la région.
Des parlementaires de cinq pays amazoniens – Brésil, Colombie, Pérou, Équateur et Bolivie – ont déjà déposé des propositions de loi dans leurs parlements nationaux. Ces initiatives visent à stopper l'expansion de l'extraction de combustibles fossiles dans leurs territoires amazoniens respectifs. Cependant, l'ambition de ces propositions varie considérablement d'un pays à l'autre, beaucoup dépendant encore fortement des industries extractives.
Points Clés
- Un rapport parlementaire mondial dénonce les impacts négatifs de l'extraction de combustibles fossiles en Amazonie.
- Plus de 900 législateurs appellent à une zone sans expansion des combustibles fossiles.
- Des propositions de loi ont été déposées dans cinq pays amazoniens.
- L'Amazonie a perdu 73% de sa capacité de stockage de carbone depuis les années 1990.
- La Colombie est perçue comme un leader potentiel dans la transition énergétique.
Impacts Dévastateurs des Combustibles Fossiles en Amazonie
L'exploration pétrolière et gazière couvre environ 1,3 million de kilomètres carrés en Amazonie. Cette surface est équivalente à près du double de la taille de la France. Le rapport « Parliamentarians for a Fossil-Free Future » identifie 871 blocs pétroliers et gaziers, à la fois terrestres et offshore. Environ 68% de ces blocs sont actuellement en phase d'étude ou d'appel d'offres. Si ces projets se concrétisent, l'exploration et la production de pétrole et de gaz pourraient plus que doubler.
Chiffres Clés
- 1,3 million km² : Surface couverte par l'exploration pétrolière et gazière en Amazonie.
- 871 : Nombre de blocs pétroliers et gaziers identifiés.
- 68% : Proportion de blocs en phase d'étude ou d'appel d'offres.
- 73% : Diminution de la capacité de stockage de carbone de l'Amazonie depuis les années 1990.
- 13% : Perte de la couverture forestière d'origine de l'Amazonie.
Les États-Unis sont la principale destination du pétrole brut amazonien. Près de la moitié des exportations traçables de pétrole amazonien sont acheminées vers les raffineries californiennes. Dix banques financent 63% de tous les projets pétroliers en Amazonie. Les deux tiers de ce financement proviennent d'Amérique du Nord et d'Europe. Malgré les importants plans de sauvetage public pour les entreprises pétrolières d'État latino-américaines, le rapport indique que seulement 5% des fonds comparables sont alloués à la réparation des écosystèmes endommagés ou au soutien des communautés affectées.
Depuis les années 1990, la capacité de stockage de carbone de l'Amazonie a chuté de manière significative. Elle est passée d'environ 1,5 milliard de tonnes par an à environ 400 millions de tonnes aujourd'hui, soit une baisse de 73%. Une étude révèle que l'Amazonie a déjà perdu 13% de sa couverture forestière d'origine. Le rapport parlementaire avertit que si la perte de végétation atteint 25%, l'Amazonie pourrait émettre 300 millions de tonnes de CO2 annuellement, au lieu d'en absorber 400 millions de tonnes. Cela rendrait les objectifs de l'Accord de Paris inatteignables.
« Ce qui manque, ce n'est pas la preuve scientifique, mais la volonté politique, »
Contexte Scientifique
Depuis le Cinquième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) en 2013, et plus tard dans le Sixième Rapport en 2021, la science a clairement établi que la combustion des combustibles fossiles est la cause principale du changement climatique. Ces rapports fournissent des preuves irréfutables des impacts anthropiques sur le climat mondial.
Le rapport souligne que l'extraction de combustibles fossiles entraîne la déforestation, la fragmentation d'écosystèmes fragiles, la pollution de l'air, la contamination de l'eau et des sols par les déversements de pétrole, les fuites et les déchets toxiques. Elle provoque également le déplacement des communautés locales, des problèmes de santé, des conflits sociaux et des violences de la part de groupes armés, y compris des attaques contre les défenseurs de l'environnement.
Une Nouvelle Impulsion Parlementaire
De nombreuses initiatives émergent avant la COP30 au Brésil en novembre. L'initiative parlementaire apporte une dimension nouvelle et potentiellement très puissante. Plusieurs sources ont confirmé à Mongabay qu'une telle union de législateurs est inédite. Ruth Luque Ibarra, députée du département de Cuzco et auteure de la proposition de loi péruvienne, déclare : « Je n'ai vu aucune autre initiative rassembler les parlementaires de cette manière. » Elle ajoute : « Nous souhaitons lancer un débat à l'échelle du continent qui se concentre sur l'Amazonie et son importance mondiale. »
Discuter de la fin de l'expansion des combustibles fossiles en Amazonie dans plusieurs parlements nationaux simultanément est une étape importante et novatrice. Juan Carlos Losada, le député qui a promu l'initiative en Colombie, affirme : « L'Amazonie ne connaît pas de frontières. Les solutions doivent être abordées de manière systématique, et non fragmentée. »
Iván Valente, député brésilien à l'origine de la proposition de loi dans son pays, estime que le débat, jusqu'à présent limité à l'activisme socio-environnemental et à quelques cercles intellectuels, doit s'élargir. « Puisqu'un projet similaire était en discussion en Colombie, nous avons décidé de proposer quelque chose de similaire au Brésil, » explique-t-il. Andrew Miller, directeur de plaidoyer chez Amazon Watch, est enthousiaste. Il rappelle que les peuples autochtones parlent de la nécessité de laisser le pétrole dans le sol depuis plus de 30 ans. Les organisations de la société civile ont également fait écho à cet appel. « C'est très stimulant que les parlementaires se concentrent sur ce sujet, car c'est un secteur politiquement très important, » dit-il.
Ambitions Variées Selon les Pays
L'ambition varie d'un pays à l'autre. Au Pérou, Ruth Luque Ibarra indique que l'objectif principal est de « générer un débat public ». En Colombie, certains espèrent que le pays pourrait devenir le premier à mettre fin à l'extraction de combustibles fossiles dans sa région amazonienne. Cependant, Andrew Miller avertit que la politique pourrait poser des défis à l'avenir des propositions, car quatre des cinq pays organiseront des élections au cours de la prochaine année.
Pessimisme au Pérou
La proposition de loi initiale au Pérou visait à mettre fin à l'extraction de pétrole et de gaz en 20 ans. Cependant, les leaders autochtones ont protesté. Ils ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas attendre deux décennies face à de graves problèmes de santé, une criminalité croissante et une insécurité sociale profonde, qu'ils attribuent à l'industrie pétrolière et minière. En réponse, Luque Ibarra demande maintenant un arrêt immédiat de l'extraction.
Avec 831 déversements de pétrole documentés dans le nord de l'Amazonie péruvienne et aucun cas connu de nettoyage complet, Luque Ibarra souligne qu'une remédiation appropriée est une demande clé des communautés autochtones. Olivia Bisa Tirko, présidente de la Nation Chapra dans le département de Loreto au Pérou, a subi un déversement de pétrole sans remédiation. En septembre 2022, sa communauté a connu « la pire situation jamais vue dans l'histoire de la Nation Chapra » après un déversement de la compagnie pétrolière publique Petroperú. Bisa a déposé six plaintes, mais affirme que la compagnie l'a ignorée et criminalisée, ainsi que d'autres manifestants.
« Il ne s'agit pas de s'impliquer, il s'agit de survivre, »
Comme de nombreux peuples autochtones, Bisa considère l'arrêt des combustibles fossiles en Amazonie comme une question de vie ou de mort. Elle explique que les peuples autochtones sont des « défenseurs de la vie » car « protéger l'eau, la forêt, les rivières et la biodiversité, c'est protéger la vie. » Elle ajoute : « Aucun politicien, aucun propriétaire de banque, aucun propriétaire de projet pétrolier ne peut vivre dans l'espace. Nous vivons tous de la Terre, nous mangeons tous ce que la Terre produit et nous buvons tous la même eau douce. »
Le combat de Bisa pour protéger la vie a entraîné des menaces contre elle et ses enfants. Elle dit avoir été criminalisée, insultée et discriminée en raison de son sexe. « Ils utilisent toutes les tactiques possibles, » dit-elle. Aujourd'hui, elle porte un gilet pare-balles lorsqu'elle voyage dans certains territoires. Bisa affirme que les défenseurs de l'environnement autochtones « sont les plus persécutés, voire éliminés », mais elle insiste pour continuer le combat. « Nous ne voulons plus de pétrole, nous ne voulons plus sacrifier de vies, » déclare-t-elle.
Situation Pétrolière au Pérou
L'industrie pétrolière péruvienne est relativement petite. En 2024, la production de pétrole brut était d'environ 41 000 barils par jour. « Le Pérou n'est pas un pays producteur de pétrole. La production nationale ne répond pas à la demande interne, » explique Gisela Hurtado. Cependant, la quasi-totalité du gaz naturel du pays est concentrée dans la région amazonienne, ce qui en fait une zone importante, selon Diego Rivera Rivota, chercheur associé senior au Center on Global Energy Policy de l'Université de Columbia.
L'adoption de la loi au Pérou pourrait être difficile en raison de la corruption, de l'autoritarisme et de l'influence des économies illicites, selon Andrew Miller. Ruth Luque Ibarra reconnaît que la « vision extractiviste » du gouvernement est le plus grand obstacle à une nouvelle loi. « Je ne pense pas que cela se concrétisera en une loi, » dit-elle, mais elle espère que cela stimulera le débat avant les élections de l'année prochaine. Elle pense également que la Colombie a de meilleures chances de produire des changements.
La Colombie en Tête de la Protection de l'Amazonie
La Colombie pourrait montrer la voie en matière de protection de l'Amazonie, selon le rapport. C'est le seul pays amazonien à avoir proposé l'arrêt des nouvelles licences pétrolières. Son président de gauche, Gustavo Petro, s'est également engagé à augmenter les investissements dans les projets d'énergie renouvelable et milite pour une interdiction de la fracturation hydraulique.
« En Colombie, nous avons une opportunité. S'il y a un pays où cela peut arriver, c'est la Colombie, » déclare Juan Carlos Losada, le député à l'origine de la proposition de loi dans le pays. Il souligne que la proposition pourrait être moins difficile à faire adopter en Colombie en raison de sa production de pétrole et de gaz relativement faible en Amazonie. Diego Rivera Rivota explique que la production de pétrole brut colombien a déjà diminué (d'environ 22% en un peu plus d'une décennie, passant de 990 000 barils par jour en 2014 à 773 000 barils par jour en 2024). Cette baisse est en partie due à un déclin naturel des réserves existantes et à un investissement limité dans l'exploration.
Pourtant, Losada affirme que l'interdiction par Petro des nouveaux contrats de forage pétrolier et gazier « n'est rien de plus qu'un moratoire, car il n'a laissé aucune réglementation qui donnerait une continuité à cette politique. » Losada insiste sur la nécessité de modifier les lois avant la fin du gouvernement Petro en août 2026. Selon Andrew Miller, Petro a eu un discours fort contre les combustibles fossiles, mais la mise en œuvre a été difficile. La Colombie autorise toujours l'exploration pétrolière dans le cadre des contrats existants.
En septembre, la ministre de l'Environnement par intérim de la Colombie, Irene Vélez, a annoncé qu'elle proposerait des restrictions sur l'exploitation minière et les combustibles fossiles en Amazonie avant la COP30. Losada soutient cette mesure, mais affirme qu'une loi passant par quatre débats au Congrès sera plus durable qu'une action exécutive. Miller convient qu'une base juridique plus solide pourrait aider à assurer une Amazonie sans combustibles fossiles, même si les gouvernements changent.
Les communautés autochtones en Colombie ont obtenu certains succès contre les projets de combustibles fossiles. Ingry Paola Mojanajinsoy, représentante légale de l'Association indigène des Cabildos Inga dans le département de Putumayo, est une des défenseures de l'environnement qui s'oppose aux projets de combustibles fossiles sur ses terres. « Nous défendons nos droits ; nous défendons notre vie qui est la terre, » dit-elle. Elle estime que la prévention de l'extraction de combustibles fossiles fait partie de ce travail. Losada prédit qu'il sera difficile de faire passer la proposition de loi au Congrès. Les commissions parlementaires clés sont soumises au lobbying des secteurs pétrolier et minier. De nombreux législateurs sont proches des industries extractives. Pourtant, il insiste : « La Colombie est le pays où nous avons la plus grande chance. »
Le Brésil sur une Voie Incertaine
Au Brésil, le projet de loi de Valente interdirait les nouveaux blocs d'exploration pétrolière et gazière dans l'Amazonie brésilienne. Il exigerait également des entreprises déjà présentes dans la région qu'elles développent des plans de récupération environnementale et sociale. Il prévoit aussi la création d'un Fonds National de Transition Énergétique pour l'Amazonie, financé par les revenus des combustibles fossiles et la coopération internationale.
Cinquante-deux pour cent des projets de combustibles fossiles (451 blocs terrestres et offshore) en Amazonie se trouvent au Brésil, selon le rapport parlementaire. Diego Rivera Rivota explique que la production pétrolière est en baisse et les prix stagnent dans la région, mais cette tendance exclut le Brésil, l'Argentine et le Guyana. Les experts affirment que l'Amazonie brésilienne détient de vastes réserves de pétrole inexploitées, jusqu'à 60 milliards de barils. Si elles étaient extraites, elles pourraient libérer 24 milliards de tonnes de CO2, dépassant les émissions totales du Brésil au cours des 11 dernières années.
Le 17 juin, l'autorité nationale brésilienne de régulation pétrolière a organisé une vente aux enchères pour 172 blocs pétroliers et gaziers, y compris sur des terres autochtones, bien qu'environ 80% n'aient pas été vendus. Un mois plus tard, le Congrès a approuvé un « projet de loi de dévastation » qui a assoupli l'octroi de licences environnementales pour les projets jugés « stratégiques », y compris l'exploration pétrolière le long de la côte amazonienne. À l'approche de la COP30, il existe une « très forte contradiction [...] entre les discours pro-action climatique et de haute ambition d'une part, et les actions concrètes du gouvernement Lula d'autre part, » analyse Andrew Miller.
« À aucun moment le gouvernement n'a travaillé sur une proposition dans cette direction, c'est pourquoi je considère qu'il est si important d'encourager le débat au Parlement, »
Valente ajoute que les politiciens du nord du Brésil s'opposent majoritairement à sa proposition de loi. Ils voient l'exploration pétrolière comme une opportunité de réduire la pauvreté. Si le Brésil poursuit l'exploration pétrolière en Amazonie, « ce serait un désastre, » prévient Valente. « Le Congrès national et le gouvernement du président Lula ont des agendas très différents, mais en ce qui concerne l'expansion des activités pétrolières, ils convergent. Je ne vois pas d'espace actuellement pour que le projet soit voté. Ce n'est qu'avec la pression populaire que nous pourrons approuver une proposition comme celle-ci. »
L'Équateur Réduit ses Ambitions
Le 15 juillet, Rosa Cecilia Baltazar Yucailla, députée à l'Assemblée Nationale de l'Équateur, a soumis une proposition visant à interdire les nouveaux projets pétroliers, gaziers et miniers dans l'Amazonie équatorienne. Alors qu'au Pérou, Luque Ibarra affichait de grandes ambitions, Baltazar vise un compromis pragmatique. « Nous allons ajuster la proposition pour qu'elle ne soit pas trop conflictuelle. C'est une proposition stratégique, » dit-elle.
Selon elle, ce sont des pays comme les États-Unis, le Canada et d'autres États développés qui devraient aider à financer la protection de l'Amazonie, conformément à la Convention sur la diversité biologique. Elle assure aux critiques que la proposition vise une transition énergétique mais ne mettra pas fin aux contrats pétroliers, gaziers et miniers existants. Baltazar reconnaît que le pouvoir exécutif, en particulier le ministère des Mines et de l'Énergie, ainsi que les entreprises, sont susceptibles de bloquer la proposition.
Recul en Équateur
L'Équateur, autrefois un modèle dans la région, recule, selon Andrew Miller. Il fait référence au non-respect par l'État d'un référendum de 2023. Lors de ce référendum, 59% des Équatoriens ont voté pour limiter le forage dans le parc national de Yasuní, la plus grande zone protégée du pays. La Cour Constitutionnelle de l'Équateur a accordé un an au gouvernement pour se conformer au résultat du réféérendum et fermer les opérations pétrolières dans le parc.
En septembre 2024, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a statué que la poursuite du forage violait les droits des autochtones et a ordonné la fermeture des puits de pétrole d'ici mars 2026. Malgré ces décisions, la compagnie publique PetroEcuador continue d'opérer dans la zone. Pendant ce temps, le ministère équatorien de l'Énergie et des Mines prévoit de mettre aux enchères les droits de 49 projets pétroliers et gaziers en Amazonie, d'une valeur de plus de 47 milliards de dollars.
Les communautés autochtones, dirigées par la Confédération des nationalités autochtones de l'Équateur, manifestent dans les rues du pays pour protester contre le gouvernement. Juan Carlos Ruiz, président de la Nation Sapara en Équateur, est l'un des manifestants. « Nous voulons défendre l'Amazonie, car c'est notre source de vie, » déclare-t-il lors d'un appel téléphonique avec Mongabay.
La Proposition Bolivienne
En Bolivie, la députée Cecilia Requena Zárate a présenté un projet de loi à la présidence du Sénat bolivien le 7 octobre. Ce projet vise à stopper les nouvelles activités d'hydrocarbures dans l'Amazonie bolivienne. Il cherche également à interdire l'expansion des zones d'exploitation actuelles et le renouvellement des contrats pétroliers et gaziers en Amazonie. Le projet de loi propose aussi d'interdire la fracturation hydraulique dans le biome amazonien et d'exiger un plan de remédiation pour assurer la réparation environnementale des dommages causés par les combustibles fossiles.
Dans une réponse écrite à Mongabay, Requena Zárate affirme qu'il sera difficile de faire passer le projet de loi. Cependant, la nécessité d'une transition énergétique en Bolivie devient « inévitable et urgente », car la production pétrolière a diminué et a contribué à une crise fiscale en Bolivie. « Cette phase fait partie du processus complexe, mais essentiel, de socialisation et d'enrichissement du projet de loi avec les acteurs clés, » écrit Requena Zárate.
Si le gouvernement poursuit sa stratégie d'expansion extractive, il est probable qu'il proposera des modifications majeures ou même recommandera de rejeter l'initiative, selon Requena. Pourtant, elle envisage également un scénario où le gouvernement renforcerait la transition énergétique et la protection de l'Amazonie. Bien que l'extraction de combustibles fossiles en Bolivie ait été concentrée en dehors du biome amazonien, le projet de loi peut aider à faire avancer des débats importants sur la future planification énergétique du pays, dit-elle.
Un Pas Vers un Avenir Sans Fossiles ?
La faisabilité de ces projets de loi varie considérablement. Cependant, les législateurs espèrent que leur alliance rapprochera l'Amazonie d'un avenir sans combustibles fossiles. Olivia Bisa Tirko exprime son espoir que la COP30 au Brésil apportera des résultats. Les politiciens doivent se souvenir qu'« ils négocient sur des millions de vies. » Selon Juan Carlos Losada, la lutte pour arrêter les combustibles fossiles en Amazonie sera probablement longue, mais « l'horloge climatique tourne contre nous. »
L'initiative fera face à l'opposition non seulement de la puissante industrie pétrolière, mais aussi des investisseurs du secteur. Certains gouvernements, médias et même des organisations criminelles transnationales profitent de l'extorsion des compagnies pétrolières ou du piratage illégal de leurs pipelines, selon Andrew Miller. « Il y a de nombreuses raisons de ne pas faire confiance au processus climatique de l'ONU pour obtenir les résultats dont nous avons besoin, » ajoute-t-il.
« J'aimerais penser que l'initiative parlementaire pourrait être utilisée comme un exemple concret pour un accord mondial, » dit Miller, bien qu'il ne pense pas que ce soit très probable. Pourtant, il le considère comme nécessaire. « Nous ne pouvons pas abandonner ; pour mes enfants, nous ne pouvons tout simplement pas abandonner. »