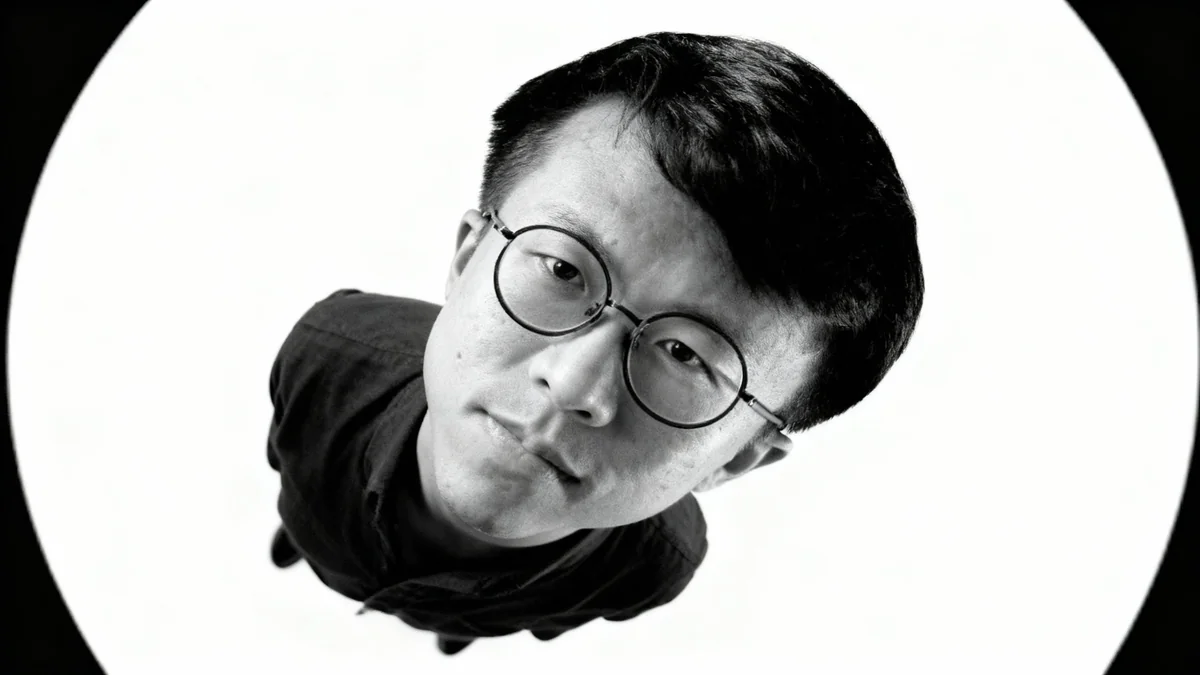Une nouvelle étude révèle que la quantité de carbone que les plantes terrestres consomment pour absorber l'azote du sol est un facteur majeur et jusqu'ici sous-estimé dans le cycle mondial du carbone. Cette dépense énergétique cachée dépasse même les émissions annuelles de carbone dues aux incendies de forêt, remettant en question certains aspects des modèles climatiques actuels.
Publiée dans la revue Nature Geoscience, la recherche menée par des scientifiques de l'Académie chinoise des sciences met en lumière un processus métabolique fondamental qui pourrait être considérablement amplifié par le réchauffement climatique.
Points Clés
- Le processus d'assimilation de l'azote par les plantes terrestres consomme 208 ± 12 térogrammes de carbone par an (Tg-C/an).
- Cette quantité est supérieure aux émissions de carbone des incendies de forêt et de la dégradation (155 Tg-C/an).
- Un réchauffement climatique de 2°C pourrait augmenter ce coût en carbone de 47 %, atteignant 249 ± 15 Tg-C/an.
- Les régions boréales et tempérées seraient les plus touchées par cette augmentation, avec des hausses respectives de 105 % et 62 %.
Un processus biologique coûteux en énergie
Les plantes, pour leur croissance, ont besoin d'azote (N) qu'elles puisent dans le sol. Cependant, l'absorption et la transformation de cet azote ne sont pas gratuites. Elles nécessitent de l'énergie, que les plantes obtiennent grâce au carbone (C) fixé lors de la photosynthèse. Ce coût métabolique a longtemps été considéré comme secondaire dans les calculs du bilan carbone mondial.
Des études biochimiques antérieures ont montré que le coût énergétique varie selon la forme d'azote absorbée. L'assimilation du nitrate est la plus gourmande en carbone, suivie de l'ammonium, puis de l'azote organique dissous.
Les différentes formes d'azote et leur coût
Les plantes utilisent principalement trois formes d'azote présentes dans le sol. Le coût en carbone pour les assimiler est différent pour chacune :
- Nitrate (NO₃⁻) : 5,81 grammes de carbone par gramme d'azote (g-C/g-N).
- Ammonium (NH₄⁺) : 4,32 g-C/g-N.
- Azote organique dissous (AOD) : 2,16 g-C/g-N.
Le nitrate, bien que courant, est donc la forme la plus « chère » en énergie pour la plante.
Jusqu'à présent, la recherche s'était principalement concentrée sur les bénéfices de l'azote pour la croissance végétale et sa capacité à stocker du carbone. Cette nouvelle étude, dirigée par le professeur Liu Xueyan, change la perspective en quantifiant pour la première fois cette « dépense carbone » à l'échelle planétaire.
Une dépense carbone plus importante que prévu
Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont développé un modèle innovant qui simule les processus isotopiques de l'azote dans le système sol-plante. Ce modèle leur a permis de déterminer la contribution de chaque forme d'azote (nitrate, ammonium, organique) à l'alimentation des plantes partout dans le monde.
En combinant ces données avec des informations sur la productivité primaire brute (la quantité totale de carbone fixée par les plantes) et les ratios carbone/azote des végétaux, ils ont pu calculer le coût global.
Un chiffre qui change la donne
L'étude estime que la consommation brute de carbone pour l'assimilation de l'azote par les plantes terrestres s'élève à 208 ± 12 térogrammes de carbone par an. Pour mettre ce chiffre en perspective, il est supérieur aux 155 térogrammes de carbone émis chaque année par les incendies de forêt et la dégradation forestière combinés.
Ce résultat démontre que ce coût métabolique est loin d'être négligeable. Il représente une part significative du carbone capté par la photosynthèse, qui n'est donc pas alloué à la croissance de la biomasse (troncs, feuilles, racines) ni stocké durablement.
Cette étude révèle un mécanisme jusqu'ici mal quantifié dans le couplage des cycles du carbone et de l'azote. C'était un véritable angle mort dans la recherche sur le cycle du carbone terrestre.
L'inclusion de ce facteur est essentielle pour affiner les bilans carbone et mieux comprendre la capacité des écosystèmes terrestres à agir comme des puits de carbone.
L'impact amplificateur du réchauffement climatique
Le changement climatique ne fait qu'exacerber ce phénomène. Les scientifiques ont utilisé leur modèle pour simuler les effets d'un réchauffement planétaire de 2°C, un scénario prévu par de nombreux modèles climatiques.
Selon leurs projections, le réchauffement accélérera les processus microbiens dans le sol, ce qui augmentera la disponibilité de l'azote inorganique, en particulier le nitrate, la forme la plus coûteuse à assimiler pour les plantes. Parallèlement, des températures plus élevées stimuleront la croissance des plantes, augmentant ainsi leur demande en azote.
Cette double dynamique entraînera une augmentation spectaculaire du coût en carbone. Les projections indiquent que ce coût atteindra 249 ± 15 Tg-C/an dans un monde plus chaud de 2°C. Cela représente une augmentation moyenne de 47 % par rapport au niveau actuel.
Des disparités régionales marquées
L'impact ne sera pas uniforme sur toute la planète. Les régions de hautes latitudes, déjà particulièrement sensibles au changement climatique, subiront les augmentations les plus fortes :
- Zones boréales : +105 %
- Régions tempérées : +62 %
- Zones tropicales : +9 %
Dans les régions boréales et tempérées, le réchauffement rendra les sols plus actifs biologiquement, libérant de grandes quantités d'azote inorganique. Les plantes devront dépenser beaucoup plus d'énergie pour l'absorber, ce qui réduira d'autant le gain net de carbone réalisé par la photosynthèse.
Implications pour les stratégies climatiques
Cette découverte a des conséquences importantes pour la modélisation du climat et l'élaboration de stratégies de lutte contre le changement climatique. Elle montre que si le réchauffement peut, dans une certaine mesure, fertiliser les écosystèmes en augmentant la disponibilité de l'azote, cet effet positif est partiellement annulé par le coût énergétique élevé de son assimilation.
Le carbone supplémentaire dépensé par les plantes pour se nourrir est du carbone qui n'est pas utilisé pour la séquestration à long terme. Ce mécanisme de rétroaction pourrait donc affaiblir la capacité des forêts, notamment dans les hautes latitudes, à fonctionner comme des puits de carbone efficaces à l'avenir.
Les auteurs soulignent que leurs travaux fournissent de nouvelles preuves pour un calcul plus précis du bilan carbone mondial. Ils appellent à intégrer ce coût métabolique dans les futurs modèles climatiques afin de formuler des stratégies de neutralité carbone plus robustes et réalistes.