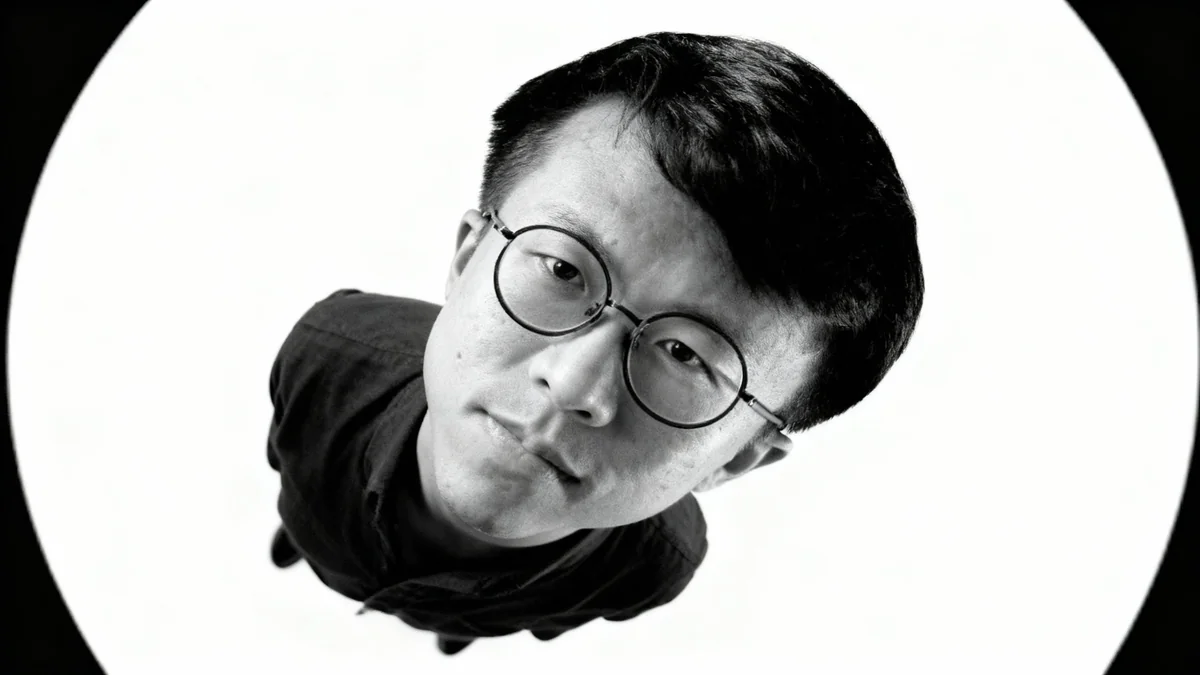Une étude récente change notre compréhension du niveau moyen mondial des mers durant la dernière ère glaciaire. Les variations étaient bien plus importantes et fréquentes que ce que les scientifiques pensaient auparavant. Cette recherche, qui remonte à 4,5 millions d'années, remet en question les modèles établis sur la dynamique des calottes glaciaires et le rythme du climat terrestre.
Points clés
- Le niveau des mers a fluctué de manière significative tout au long de l'ère glaciaire, pas seulement à la fin.
- Les océans étaient parfois 20 mètres plus hauts qu'aujourd'hui et parfois 130 mètres plus bas.
- De grandes calottes glaciaires existaient bien avant la transition du Pléistocène moyen.
- La nouvelle méthode sépare la température du volume de glace pour des mesures plus précises.
Les océans ont connu des hauts et des bas drastiques. Au début de cette période, il y a environ 4,5 à 3 millions d'années, le niveau des mers pouvait être 20 mètres plus élevé que le niveau actuel. Cela suggère que les calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland étaient alors plus petites.
Plus tard, il y a environ 2,5 millions d'années, les niveaux bas ont atteint des profondeurs comparables à celles du dernier maximum glaciaire, soit environ 130 mètres en dessous du niveau actuel. Ces profondeurs indiquent des calottes glaciaires aussi massives que les plus récentes.
Des calottes glaciaires dynamiques
Peter U. Clark, de l'Université d'État de l'Oregon, et son équipe ont reconstitué le niveau moyen mondial des mers. Ils ont découvert que de grandes calottes glaciaires se sont développées et ont reculé pendant une grande partie du Pléistocène. Cela signifie que les grandes fluctuations du niveau des mers n'étaient pas un phénomène tardif.
"C'est un changement de paradigme dans notre compréhension de l'histoire de l'ère glaciaire", a déclaré Clark. Il a souligné que les modèles antérieurs avaient sous-estimé le dynamisme des calottes glaciaires terrestres.
Les chercheurs n'avaient pas perçu les montées et les baisses répétées des mers anciennes, bien avant le pic final de l'ère glaciaire. Cette nouvelle perspective modifie notre vision des cycles climatiques passés.
Fait intéressant
Pour cette étude, l'équipe a utilisé des foraminifères benthiques, de minuscules organismes marins dont les coquilles conservent des informations sur les conditions océaniques passées. Leurs signaux d'oxygène permettent de retracer la température de l'océan et la quantité d'eau emprisonnée sous forme de glace sur terre.
Une nouvelle méthode de mesure
Pour obtenir ces résultats, l'équipe a d'abord séparé la température du volume de glace. Ils ont utilisé une reconstruction globale de la température développée en 2024. Cela leur a permis de traduire le signal d'oxygène de l'eau de mer en niveau de la mer. Ils ont évité les anciennes hypothèses qui pouvaient fausser les calculs.
Ils ont ensuite comparé leur courbe aux enregistrements d'oxygène des fonds marins, comme la base de données LR04. Cette base est une référence pour le rythme de l'ère glaciaire. L'approche classique mélange la température et la glace, mais la nouvelle méthode évite une conversion constante. Elle prend en compte comment les climats plus chauds modifient le "poids" isotopique de la glace.
Cette étude révèle que de nombreux cycles précoces étaient déjà aussi importants que les cycles ultérieurs en termes de volume de glace et de niveau de la mer.
La transition du Pléistocène moyen
La transition du Pléistocène moyen (TPM), qui s'est déroulée il y a environ 1,2 à 0,62 million d'années, marque le passage de cycles dominés par une période de 41 000 ans à des cycles de 100 000 ans. Les reconstructions antérieures liaient la TPM à des calottes glaciaires qui ne cessaient de croître, n'atteignant leur taille maximale que tardivement.
Contexte
L'inclinaison axiale de la Terre, un lent balancement qui modifie la répartition de la lumière solaire, a une période proche de 41 000 ans. Ce phénomène, appelé obliquité, joue un rôle crucial dans les cycles glaciaires.
L'analyse de Clark suggère une histoire différente. De grandes calottes glaciaires existaient bien avant la TPM. Cela signifie que le rythme a changé, mais pas la taille fondamentale des glaciers. Un facteur possible est l'inclinaison axiale de la Terre. Cette inclinaison a une période d'environ 41 000 ans.
L'étude suggère que pendant la TPM, des changements dans le cycle du carbone de l'océan Austral ont amplifié les variations de CO2 atmosphérique à l'échelle de 100 000 ans. Cela aurait stimulé les cycles de température et influencé le moment où les calottes glaciaires ont franchi leur seuil de stabilité.
Implications pour les modèles climatiques
Un seuil notable apparaît dans les données. Lorsque le niveau moyen mondial des mers chutait d'environ 79 mètres en dessous des niveaux modernes, les calottes glaciaires avaient tendance à devenir instables lors de la prochaine augmentation de l'obliquité. Cela déclenchait une déglaciation majeure.
Les tests de modèles mettent également en évidence le rôle de la hauteur de la glace. Les surfaces de glace plus élevées restent plus froides. Elles peuvent maintenir un bilan de masse de surface positif dans des conditions qui feraient fondre une glace plus courte. Si de grandes calottes glaciaires sensibles étaient courantes pendant le Pléistocène, alors le système climatique terrestre contient de puissantes rétroactions internes.
Ces rétroactions peuvent faire basculer les calottes glaciaires entre la croissance et la désintégration lorsque les conditions franchissent certains seuils. L'idée que les processus de l'océan Austral ont modulé le CO2 pendant la TPM concorde avec les plus longs enregistrements de carottes de glace antarctiques. Les données de CO2 à haute résolution des 800 000 dernières années montrent des variations répétées de 100 000 ans.
Vers une meilleure compréhension future
Cette nouvelle histoire du niveau des mers aide aussi à évaluer la rapidité avec laquelle les océans peuvent monter ou descendre. C'est important car le taux actuel est accéléré par le réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Les facteurs sont différents de ceux du rythme orbital des ères glaciaires.
"La présence de ces grandes calottes glaciaires tout au long de cette période signifie que leur formation et leur désintégration ont probablement été influencées par des rétroactions internes du système climatique, plutôt que par des dynamiques externes", a expliqué Clark.
Étendre les enregistrements directs de CO2 au-delà de 800 000 ans permettrait aux chercheurs de tester le lien proposé avec le cycle du carbone de l'océan Austral sur l'ensemble de la TPM. De nouveaux projets de forage visent à récupérer de la glace plus ancienne. Cela pourrait aider à déterminer comment les gaz à effet de serre ont fluctué avant cette limite.
De meilleures contraintes sur le niveau moyen mondial des mers passé affineront la manière dont les modèles traitent la physique de la glace, le stockage de la chaleur océanique et les rétroactions entre les nuages, les vents et les chutes de neige. Cela inclut la question de savoir si le comportement du seuil d'obliquité est valable dans différents contextes de température et de dioxyde de carbone.
Enfin, la découverte que de grandes calottes glaciaires sont apparues tôt signifie que les côtes passées se sont déplacées souvent. Les marqueurs géologiques des rivages lointains peuvent être vérifiés par rapport à la courbe mise à jour. Cela permettra de repérer les incohérences et d'améliorer les deux ensembles de données.