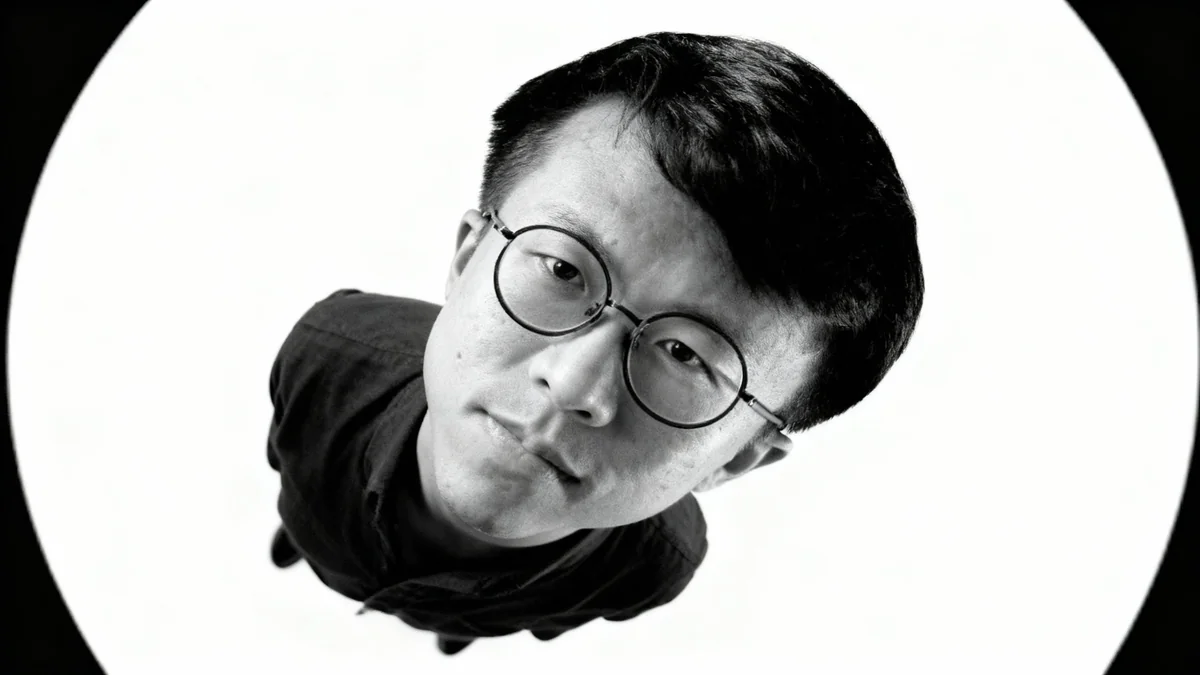Une nouvelle étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters révèle que des sols anormalement secs dans le nord du Mexique peuvent provoquer des épisodes de sécheresse et de canicule simultanés, appelés « sécheresses chaudes », à des centaines de kilomètres de distance dans le sud-ouest des États-Unis. Ce phénomène, observé avec une intensité record en 2023, affecte des États comme l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas.
Les chercheurs ont découvert que ces événements extrêmes persistent de plus en plus jour et nuit, empêchant tout répit pour les écosystèmes et les populations. Cette connexion transfrontalière pourrait permettre de développer des systèmes d'alerte précoce pour mieux anticiper et gérer ces crises climatiques.
Points Clés
- L'assèchement des sols au Mexique est directement lié aux « sécheresses chaudes » dans le sud-ouest américain.
- L'événement de 2023 a vu les températures augmenter jusqu'à 8 °C au-dessus des normales saisonnières.
- Les nuits n'offrent plus de refroidissement, aggravant les risques sanitaires et environnementaux.
- La surveillance de l'humidité des sols au Mexique pourrait servir de système d'alerte précoce.
Un phénomène climatique transfrontalier
Une étude menée par des scientifiques de l'Arizona State University et de la Northeastern University a analysé les conditions hydroclimatiques de l'été 2023 dans le sud-ouest de l'Amérique du Nord. Les résultats montrent une corrélation forte et croissante entre l'humidité des sols dans le nord du Mexique et l'apparition de sécheresses chaudes dans les États voisins du nord.
Ce type de sécheresse combine un manque de précipitations et des températures anormalement élevées. Selon les auteurs de l'étude, ces événements ont des conséquences bien plus graves qu'une simple canicule ou une sécheresse isolée, notamment sur l'agriculture, le risque d'incendies et la santé humaine.
« Les sécheresses chaudes se propageront à d'autres régions du pays et auront des effets néfastes sur la santé, les infrastructures et la vie quotidienne », a déclaré Enrique Vivoni, hydrologue à l'Arizona State University et auteur principal de l'étude.
Qu'est-ce qu'une sécheresse chaude ?
Pour cette étude, les chercheurs ont défini une sécheresse chaude comme une période où au moins deux semaines de précipitations anormalement faibles coïncident avec au moins trois jours consécutifs de températures exceptionnellement élevées. Ce phénomène amplifie les effets négatifs de la chaleur et du manque d'eau.
L'été 2023 : un cas d'école
L'été 2023 a servi de modèle pour les chercheurs en raison de son intensité exceptionnelle. La région a connu une sécheresse chaude dont la sévérité a été près de cinq fois supérieure à la moyenne des quarante dernières années. Les températures diurnes, qui se situent normalement entre 35 et 40 degrés Celsius, ont grimpé jusqu'à 8 degrés de plus.
Cette situation a été principalement causée par des schémas météorologiques qui ont affaibli la mousson nord-américaine. Ce phénomène saisonnier, qui se déroule de juillet à septembre, apporte habituellement entre 40 % et 80 % des précipitations annuelles de la région. Son affaiblissement a aggravé la sécheresse déjà en place.
« Le manque de précipitations peut augmenter la chaleur, ce qui peut encore intensifier la perte d'eau », note Somnath Mondal, hydroclimatologue à la Northeastern University et co-auteur de l'étude.
Le rôle crucial des sols mexicains
L'une des découvertes les plus surprenantes de l'étude est l'influence prépondérante des sols mexicains. Normalement, l'humidité évaporée des sols au Mexique contribue à former des nuages de pluie qui se déplacent vers le nord. En 2023, les sols mexicains étaient si secs que ce cycle a été interrompu, propageant la chaleur et la sécheresse au-delà de la frontière.
L'analyse a révélé que l'état des sols au Mexique avait une influence plus forte sur la sécheresse chaude en Arizona que l'état des sols en Arizona même. « En 2023, le Mexique a influencé la sécheresse chaude de l'Arizona de manière plus marquée que le sol de l'Arizona lui-même », a précisé Somnath Mondal, ajoutant avoir vérifié ce calcul à cinq reprises.
Des nuits qui ne rafraîchissent plus
Un autre constat alarmant concerne les températures nocturnes. Traditionnellement, dans les climats désertiques, la chaleur accumulée pendant la journée se dissipe après le coucher du soleil. Cependant, lors d'événements extrêmes comme celui de 2023, la chaleur est si intense qu'elle persiste durant la nuit.
Cette chaleur nocturne résiduelle s'ajoute à celle du jour suivant, créant un cycle d'intensification qui peut durer des semaines. Les chercheurs ont observé que ce phénomène est de plus en plus fréquent depuis 40 ans, y compris dans les zones rurales qui retiennent habituellement moins la chaleur que les zones urbaines.
Impact sur la santé publique
L'absence de refroidissement nocturne augmente considérablement les risques pour la santé, comme les coups de chaleur et la mortalité liée à la chaleur. Les travailleurs en extérieur et les randonneurs, même ceux qui commencent leurs activités tôt le matin pour éviter les pics de chaleur, sont de plus en plus en danger.
Vers des systèmes d'alerte précoce
Les conclusions de l'étude ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de prévention. En surveillant l'humidité des sols dans les régions en amont, comme le nord du Mexique, il serait possible d'anticiper l'arrivée d'une sécheresse chaude dans les régions en aval.
De tels systèmes d'alerte permettraient aux communautés de se préparer en amont, par exemple en limitant les heures de travail en extérieur, en protégeant les personnes vulnérables et en ouvrant des centres de rafraîchissement. « Nous avons besoin de systèmes pour nous alerter des sécheresses chaudes, tout comme nous avons des systèmes qui nous alertent des ouragans », insiste Enrique Vivoni.
Les chercheurs prévoient de développer des modèles pour mieux comprendre la physique de la propagation de ces phénomènes. Ils souhaitent également déterminer si ce transfert de sécheresse chaude se produit dans d'autres régions arides et moussonnières, comme à la frontière entre l'Inde et le Pakistan.
Cette recherche souligne une réalité fondamentale de notre époque : les phénomènes climatiques ne connaissent pas de frontières nationales. « Nous sommes plus interconnectés que nous ne le pensions », conclut Enrique Vivoni, rappelant l'urgence d'une coopération internationale pour faire face aux impacts croissants du changement climatique.