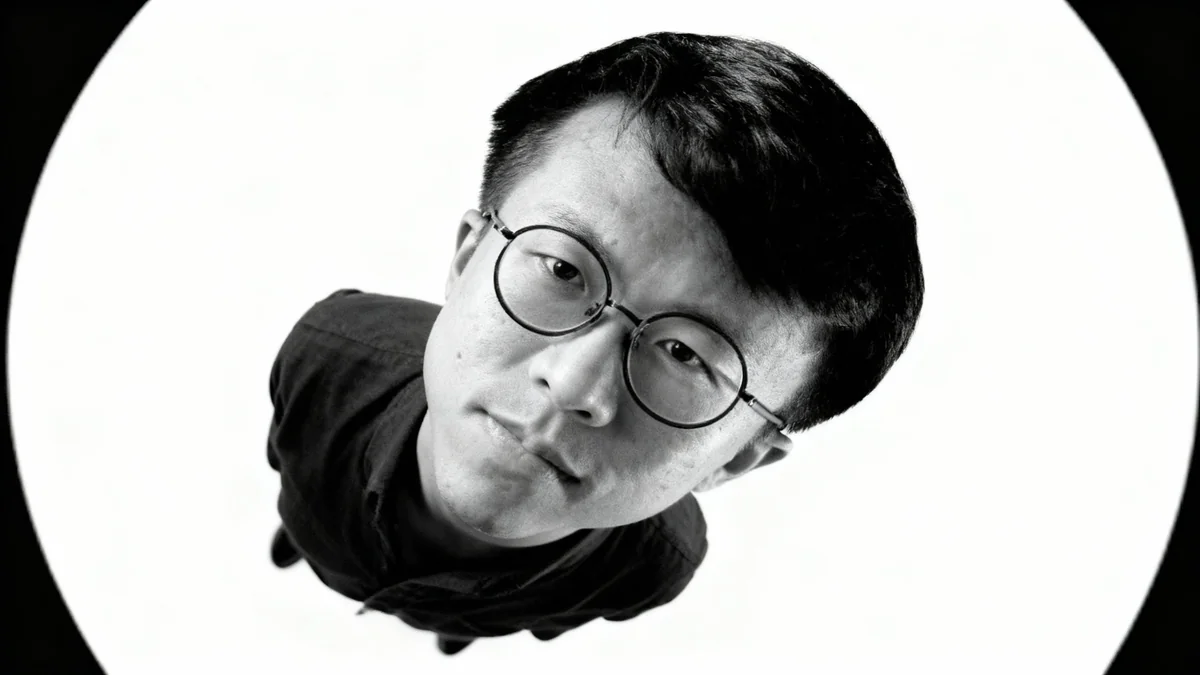Une nouvelle étude menée par une quarantaine de scientifiques internationaux met en garde contre les projets de géo-ingénierie visant à lutter contre le changement climatique. Selon leurs conclusions, ces interventions technologiques à grande échelle sont non seulement coûteuses et peu pratiques, mais elles pourraient également entraîner des conséquences environnementales dévastatrices et imprévues.
Points Clés
- Les projets de géo-ingénierie, comme l'injection de particules dans l'atmosphère, présentent des risques importants, notamment la perturbation des moussons mondiales.
- Une étude menée par 40 experts conclut qu'aucune des propositions actuelles n'est réalisable, sûre ou économiquement viable.
- Les scientifiques soulignent que ces technologies ne traitent pas la cause profonde du changement climatique : les émissions de gaz à effet de serre.
- Malgré les doutes scientifiques, ces idées gagnent en visibilité auprès des décideurs politiques, en partie grâce à des campagnes de relations publiques.
Comprendre la géo-ingénierie
La géo-ingénierie désigne un ensemble de technologies visant à manipuler délibérément les systèmes climatiques de la Terre pour contrer les effets du réchauffement planétaire. Ces propositions s'inspirent souvent de phénomènes naturels. Par exemple, l'idée d'injecter des particules dans la stratosphère imite l'effet refroidissant des éruptions volcaniques, qui libèrent des aérosols réfléchissant la lumière du soleil.
D'autres concepts incluent la construction de gigantesques murs sous-marins pour empêcher l'eau chaude d'atteindre les glaciers polaires ou le pompage d'eau pour épaissir la glace de mer. Bien que ces idées puissent sembler innovantes, elles restent largement théoriques et non testées à grande échelle.
Inspiration volcanique
L'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 a libéré des millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère. Ces particules ont formé un voile d'aérosols qui a réfléchi la lumière du soleil, provoquant une baisse temporaire de la température mondiale d'environ 0,5 °C. C'est ce phénomène que certains projets de géo-ingénierie solaire cherchent à reproduire artificiellement.
Une étude révèle des risques majeurs
Une équipe de 40 experts en glaciologie, sciences de l'atmosphère, océanographie et biologie marine a examiné en détail plusieurs de ces propositions. Leurs recherches, publiées dans une revue scientifique évaluée par les pairs, concluent que les dangers potentiels l'emportent largement sur les avantages escomptés.
L'un des risques les plus préoccupants est la perturbation des régimes de précipitations. La dispersion de particules dans l'atmosphère pourrait modifier radicalement les schémas météorologiques, affectant potentiellement les moussons dont dépendent des milliards de personnes pour l'agriculture en Asie et en Afrique.
Les interventions mécaniques dans les régions polaires pourraient également avoir des effets en cascade. Selon les chercheurs, la construction de structures sous-marines ou le pompage massif d'eau perturberait les écosystèmes marins fragiles, affectant toute la chaîne alimentaire, du krill aux baleines.
« La géo-ingénierie pourrait ne traiter que les symptômes du changement climatique, et non sa cause profonde », a déclaré Martin Siegert, glaciologue à l'Université d'Exeter et auteur principal de l'étude.
Faisabilité, coûts et obstacles juridiques
Pour évaluer chaque concept, les auteurs de l'étude ont développé un cadre d'analyse rigoureux. Ils ont examiné si l'intervention pouvait fonctionner en pratique, quels étaient les risques prévisibles et imprévus, et quels seraient les coûts financiers.
Les conclusions sont sans appel : la plupart des projets sont logistiquement irréalisables. Mettre en œuvre ces plans dans des environnements aussi hostiles et éloignés que les pôles représente un défi technique et humain colossal. De plus, les coûts sont prohibitifs, estimés à des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars.
Un défi d'échelle
Pour être efficace, toute intervention de géo-ingénierie devrait être déployée à une échelle planétaire et maintenue sur plusieurs décennies. Selon l'étude, la logistique nécessaire pour de telles opérations dépasse les capacités actuelles et soulève des questions de gouvernance mondiale complexes.
Enfin, des obstacles juridiques et éthiques se dressent. Les traités internationaux, comme le Traité sur l'Antarctique, protègent ces écosystèmes vierges et limitent strictement les interventions à grande échelle. Toute tentative de modifier l'environnement polaire nécessiterait un consensus international difficile à obtenir.
Une influence politique grandissante
Malgré le scepticisme de la communauté scientifique, les idées de géo-ingénierie gagnent du terrain dans certaines sphères politiques. James Kirkham, co-auteur de l'étude et conseiller scientifique, a observé que ces concepts étaient promus lors d'événements de haut niveau comme la conférence sur le climat COP28.
Il s'inquiète du fait que ces propositions soient souvent présentées comme si elles bénéficiaient d'un large soutien scientifique, ce qui n'est pas le cas. Selon lui, cette visibilité accrue est en partie due à l'implication de professionnels des relations publiques qui façonnent la perception du public et des décideurs.
Cette tendance détourne l'attention et les ressources des solutions éprouvées et durables. Les chercheurs insistent sur le fait que la priorité absolue doit rester la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre.
La seule voie viable : réduire les émissions
Le débat sur la géo-ingénierie met en lumière l'urgence d'adopter des politiques climatiques claires et fondées sur des preuves scientifiques. L'étude conclut qu'il ne faut pas se laisser séduire par des « solutions » technologiques rapides qui pourraient créer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent.
Les auteurs appellent à une plus grande prudence et à un dialogue international sur les implications éthiques et environnementales de ces technologies. Pour l'instant, la seule stratégie sûre et efficace pour stabiliser le climat reste de s'attaquer à la racine du problème : notre dépendance aux combustibles fossiles.