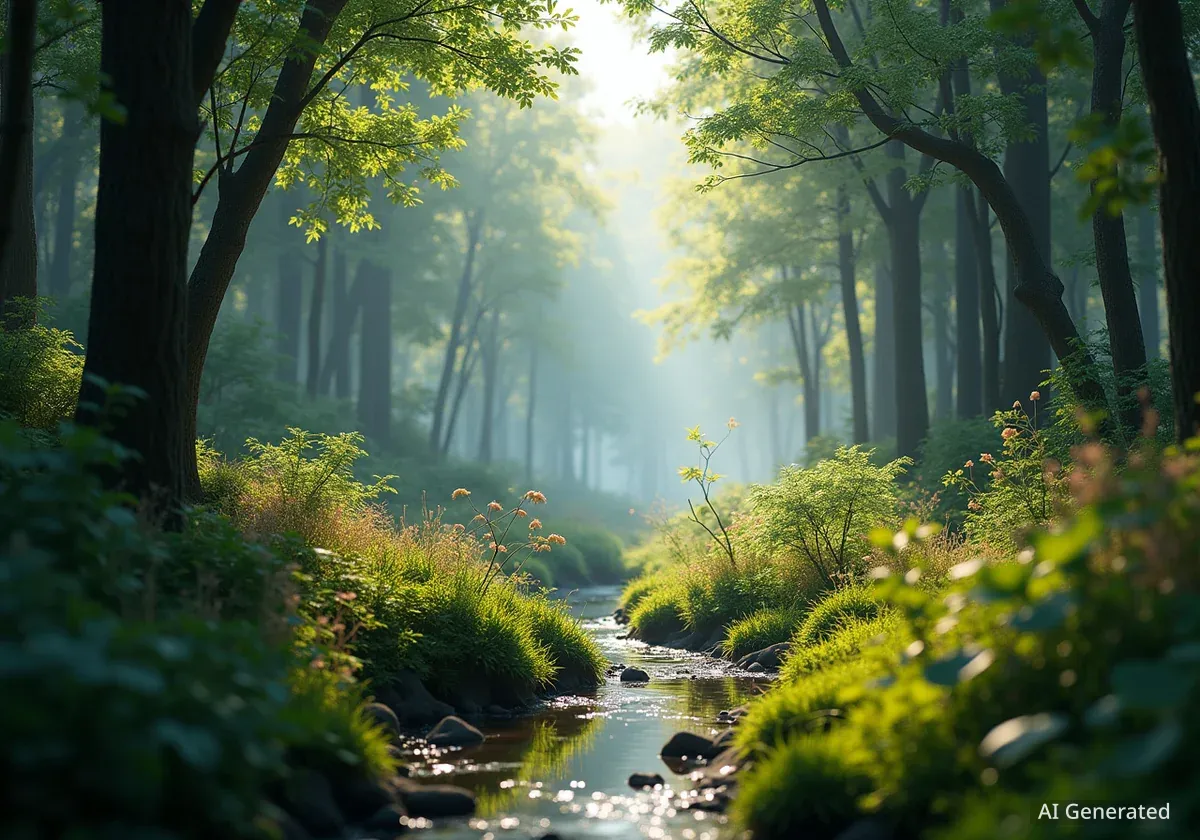La dégradation des écosystèmes augmente le risque de maladies zoonotiques, celles qui passent de l'animal à l'homme. Une nouvelle étude publiée dans Nature Ecology & Evolution, menée par Frauke Ecke et son équipe internationale, souligne l'importance d'une restauration adaptative des écosystèmes pour atténuer ces risques. Les chercheurs proposent six considérations clés pour évaluer l'impact de ces efforts de restauration sur la propagation des pathogènes.
Alors que les perturbations comme le changement d'affectation des terres, l'empiètement humain et le changement climatique forcent les espèces sauvages à s'adapter, elles augmentent également la probabilité que des pathogènes zoonotiques se transmettent à l'homme. La littérature scientifique sur l'effet protecteur de la restauration écologique est fragmentée. Cette nouvelle perspective vise à fournir un cadre conceptuel et des lignes directrices pratiques pour mieux comprendre et maximiser les bénéfices de la restauration.
Points Clés
- La dégradation des habitats augmente les risques de maladies zoonotiques.
- La restauration des écosystèmes peut réduire ces risques, mais nécessite une approche structurée.
- Six considérations sont essentielles pour évaluer l'efficacité de la restauration.
- L'intégration du réensauvagement trophique est un élément crucial.
- L'engagement des communautés locales est indispensable au succès des projets.
Le lien entre la dégradation des habitats et les maladies
Les maladies infectieuses représentent une menace majeure pour la sécurité sanitaire mondiale. Les espèces sauvages, souvent hôtes de nombreux agents pathogènes zoonotiques, sont de plus en plus affectées par les changements d'utilisation des terres, l'empiètement humain et le changement climatique. Ces perturbations forcent les animaux à s'adapter, ce qui peut créer des conditions favorables à la transmission de maladies à l'homme.
Une étude de Jones et al. (2008) avait déjà montré des tendances mondiales d'augmentation des maladies infectieuses émergentes. Plus récemment, Carlson et al. (2025) ont exploré les liens entre les pathogènes et les changements planétaires. Ces travaux mettent en évidence un consensus croissant sur l'augmentation des risques zoonotiques liés à la dégradation des écosystèmes.
Fait Important
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 60% des maladies infectieuses humaines connues sont d'origine zoonotique. Ce chiffre souligne l'urgence de comprendre et de gérer les interactions entre la faune, l'environnement et la santé humaine.
Malgré ces preuves, la recherche sur les effets atténuants de la restauration des écosystèmes sur le débordement zoonotique (spillover) reste dispersée. Elle manque souvent d'un cadre conceptuel clair et de conseils pratiques. Cette lacune rend difficile l'évaluation rigoureuse des interventions de restauration.
Six considérations pour une restauration efficace
Face à l'urgence d'une restauration à grande échelle des écosystèmes, les auteurs identifient six points cruciaux. Ne pas tenir compte de ces éléments pourrait compromettre les efforts scientifiques et mondiaux visant à inverser le déclin de la biodiversité.
- Évaluation des objectifs de maladies zoonotiques : Il est vital de définir clairement les pathogènes ou les syndromes zoonotiques ciblés par la restauration. Cela permet de mesurer l'efficacité de manière spécifique.
- Délai entre la restauration et la récupération : La restauration prend du temps. Comprendre les délais nécessaires pour que les écosystèmes se rétablissent et que les risques zoonotiques diminuent est essentiel pour des attentes réalistes et une planification à long terme.
- Intégration du réensauvagement trophique : Le retour de grands prédateurs ou d'espèces clés peut rétablir des équilibres écologiques. Cela peut indirectement réduire les populations d'hôtes réservoirs de pathogènes.
- Conceptions d'études robustes : Des méthodologies de recherche solides sont nécessaires pour isoler les effets de la restauration des autres facteurs environnementaux. Cela inclut des études comparatives et longitudinales.
- Contrôle des facteurs confondants et modificateurs : De nombreux facteurs influencent la dynamique des maladies. Il est crucial de tenir compte des changements climatiques, de l'utilisation des terres et des activités humaines pour évaluer précisément l'impact de la restauration.
- Engagement des parties prenantes et co-création avec les communautés : L'implication des populations locales est fondamentale. Leurs connaissances et leur participation active assurent la durabilité et l'acceptation des projets de restauration.
« Ignorer ces considérations rend la contribution scientifique de la restauration moins pertinente et peut même entraver les efforts mondiaux pour inverser le déclin de la biodiversité, » affirment les auteurs de l'étude.
Contexte du Problème
Le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 de l'ONU a fixé des objectifs de restauration de 15% des écosystèmes dégradés. La Décennie des Nations Unies pour la Restauration des Écosystèmes (2021-2030) vise à accélérer ces efforts. Ces initiatives montrent une reconnaissance mondiale de l'importance de la restauration.
Le rôle du réensauvagement trophique
Le réensauvagement trophique consiste à réintroduire des espèces clés, souvent des prédateurs, pour restaurer les interactions écologiques naturelles. Par exemple, la réintroduction de loups dans le Parc National de Yellowstone a eu des effets en cascade, modifiant le comportement des élans et favorisant la repousse de la végétation. De tels changements peuvent influencer la distribution et l'abondance des hôtes de pathogènes.
Une étude de Stier et al. (2016) a montré comment le rétablissement des prédateurs supérieurs peut avoir des effets complexes sur les écosystèmes. Dans le contexte des maladies zoonotiques, cela pourrait signifier une réduction des populations de rongeurs porteurs de virus, par exemple, grâce à une augmentation des prédateurs naturels.
Exemple de Réensauvagement
Le projet de réintroduction de 2000 rhinocéros par African Parks vise à restaurer des populations clés, ce qui peut avoir un impact significatif sur la santé de l'écosystème et, potentiellement, sur la dynamique des maladies.
Cependant, les effets du réensauvagement ne sont pas immédiats. Il peut y avoir un délai significatif entre la réintroduction d'espèces et la manifestation des bénéfices écologiques complets. Cette période doit être prise en compte dans la planification et l'évaluation des projets.
L'importance des études robustes et de l'engagement local
Pour évaluer l'impact réel de la restauration sur les risques zoonotiques, des études scientifiques rigoureuses sont indispensables. Cela inclut l'utilisation de groupes témoins, la collecte de données sur de longues périodes et la prise en compte de multiples variables environnementales.
Les facteurs confondants, tels que les changements climatiques ou les variations socio-économiques, peuvent masquer ou amplifier les effets de la restauration. Il est donc crucial de développer des modèles statistiques sophistiqués pour isoler l'impact spécifique des interventions.
L'engagement des communautés locales est également un facteur de succès majeur. Les populations indigènes et les communautés locales possèdent souvent des connaissances écologiques traditionnelles précieuses. Leur participation à la conception et à la mise en œuvre des projets de restauration peut améliorer l'efficacité et la durabilité des actions.
- Les projets de restauration communautaire au Mexique ont montré que l'intégration des perceptions locales et des connaissances traditionnelles est essentielle (Ortega-Álvarez et al., 2022).
- L'initiative 'Green Aral Sea' du PNUD, qui vise à planter une forêt sur le lit asséché de la mer d'Aral, est un exemple d'effort de restauration à grande échelle nécessitant un engagement communautaire fort.
En somme, une approche adaptative de la restauration des écosystèmes, intégrant ces six considérations, est essentielle pour réduire les risques de maladies zoonotiques et renforcer la sécurité sanitaire mondiale.