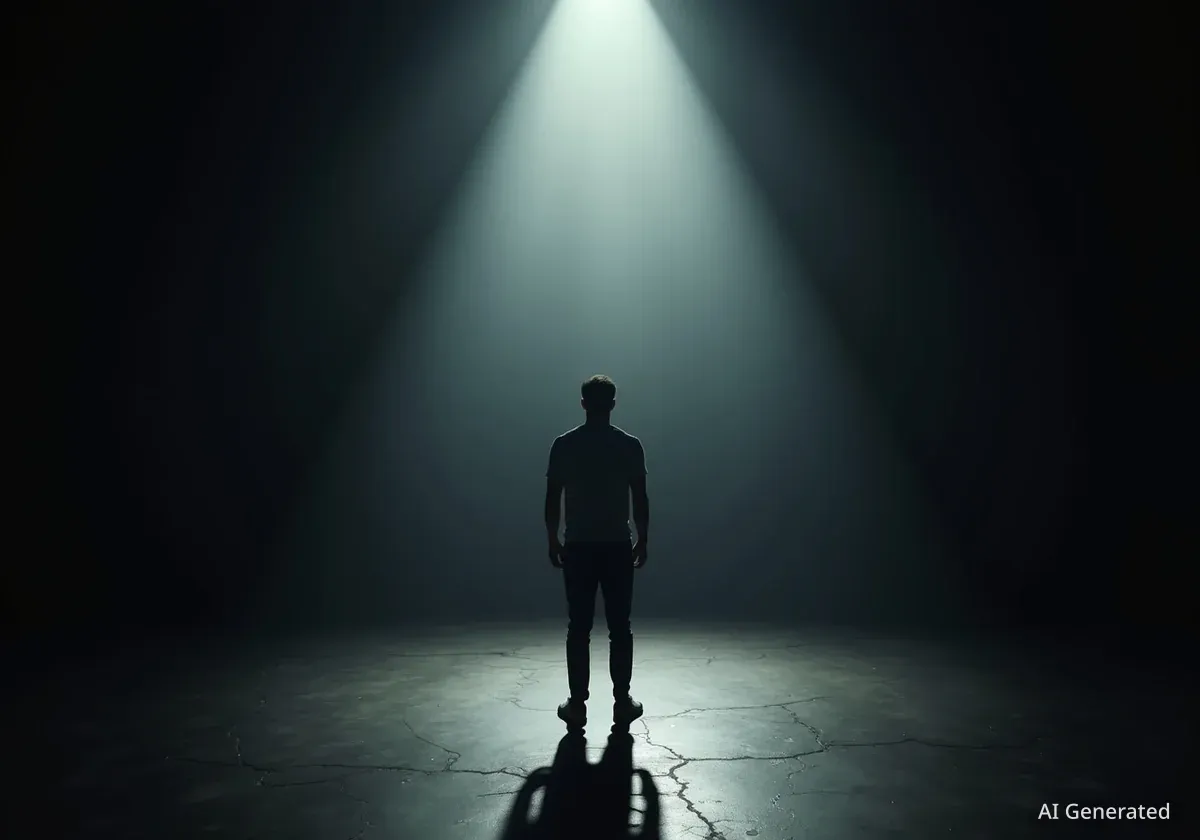Une nouvelle pièce présentée au Lincoln Center Theater à New York plonge les spectateurs dans les coulisses tendues des négociations qui ont mené au Protocole de Kyoto en 1997. Intitulée sobrement « Kyoto », cette œuvre dramatique explore les compromis politiques, les pressions des lobbies et les espoirs d'une génération face à l'urgence climatique naissante.
Racontée du point de vue d'un lobbyiste du pétrole, la pièce ne se contente pas de reconstituer un événement historique ; elle interroge notre rapport au passé et notre capacité à trouver un consensus mondial pour affronter les défis environnementaux actuels. C'est une incursion rare et audacieuse dans un moment charnière de l'histoire du climat.
Points Clés
- Une nouvelle pièce de théâtre, « Kyoto », a débuté au Mitzi E. Newhouse Theater du Lincoln Center.
- L'œuvre dramatise les négociations internationales ayant abouti au Protocole de Kyoto de 1997.
- Le récit est porté par un narrateur inattendu : Don Pearlman, un lobbyiste de l'industrie pétrolière à Washington.
- La pièce explore la nostalgie des années 1990 tout en soulignant la complexité et l'urgence des actions climatiques.
Le théâtre comme arène politique
Le théâtre a toujours été un miroir de la société, un lieu où les débats les plus complexes peuvent être incarnés et rendus accessibles. La pièce « Kyoto » s'inscrit pleinement dans cette tradition en s'attaquant à un sujet dense et souvent technique : la diplomatie climatique internationale. L'objectif est de transformer des heures de pourparlers et des documents complexes en une expérience humaine captivante.
En choisissant de mettre en scène les négociations du Protocole de Kyoto, les créateurs, déjà connus pour leur pièce immersive « The Jungle », montrent que les décisions qui façonnent notre monde ne sont pas le fruit de processus abstraits. Elles sont le résultat de confrontations, d'alliances et de conflits entre des individus aux intérêts divergents.
Cette approche permet de révéler les tensions sous-jacentes. D'un côté, la pression scientifique pour une action immédiate. De l'autre, les impératifs économiques et les jeux de pouvoir entre les nations. Le théâtre offre un cadre unique pour explorer ces dynamiques sans simplification excessive.
Un narrateur au cœur du conflit
Le choix du narrateur est l'un des aspects les plus percutants de la pièce. En donnant la parole à Don Pearlman, un lobbyiste du pétrole, l'œuvre évite un manichéisme facile. Le public est invité à voir les événements à travers les yeux de quelqu'un dont le rôle était de freiner, voire de saboter, un accord climatique ambitieux.
Ce personnage complexe, interprété par Stephen Kunken, n'est pas présenté comme un simple antagoniste. Il incarne une vision du monde, une défense des intérêts industriels qui faisaient partie intégrante du débat de l'époque. Cette perspective offre une profondeur inattendue au récit, forçant le spectateur à confronter des arguments qui, bien que controversés, ont pesé lourd dans la balance des négociations.
Retour sur les années 1990
La pièce s'ouvre sur une note de nostalgie. « Les années 1990 étaient carrément glorieuses », lance le narrateur, une phrase qui suscite des réactions dans le public. Cette observation n'est pas anodine. Elle établit un contraste puissant entre la perception d'une décennie souvent vue comme une période d'optimisme et la réalité des menaces qui se profilaient déjà.
Le Protocole de Kyoto : un jalon historique
Signé le 11 décembre 1997 au Japon, le Protocole de Kyoto était le premier accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il engageait les pays industrialisés à atteindre des objectifs de réduction chiffrés. Bien que les États-Unis ne l'aient jamais ratifié, il a représenté une étape fondamentale dans la prise de conscience mondiale du changement climatique.
Pourtant, la pièce nuance rapidement cette vision idéalisée. Elle rappelle que les années 90 n'étaient pas seulement une époque d'insouciance, mais aussi le moment où des décisions cruciales pour l'avenir de la planète devaient être prises. Le consensus de Kyoto, bien qu'imparfait, est présenté comme un possible modèle d'espoir, une démonstration que la coopération internationale est possible même sur les sujets les plus épineux.
En replongeant le public dans ce contexte, « Kyoto » agit comme un rappel historique. Elle montre comment les arguments, les acteurs et les obstacles d'hier continuent de résonner dans les débats climatiques d'aujourd'hui.
Transformer la diplomatie en drame
Comment rendre captivantes des négociations longues et ardues ? C'est le défi principal que relève la mise en scène. Plutôt que de se perdre dans les détails techniques des articles du traité, la pièce se concentre sur les interactions humaines, les stratégies et les moments de tension qui ont ponctué les discussions.
Les scènes dépeignent des réunions en coulisses, des conversations informelles dans les couloirs et des affrontements directs entre les délégués. On y voit la difficulté de trouver un terrain d'entente entre des pays aux réalités économiques et sociales très différentes. La pièce met en lumière le rôle des personnalités, leurs convictions, leurs doutes et les pressions qu'elles subissent.
Le Protocole de Kyoto a été le fruit de négociations complexes impliquant plus de 150 pays. L'un des points de friction majeurs était la distinction entre les responsabilités des pays développés, historiquement les plus grands émetteurs, et celles des pays en développement.
Le rythme est soutenu, passant d'un groupe de négociateurs à un autre, illustrant le caractère mondial et fragmenté des discussions. Le décor et les lumières contribuent à créer une atmosphère de pression constante, où chaque mot prononcé peut faire basculer l'issue des pourparlers.
« La pièce ne cherche pas à donner une leçon, mais à montrer la complexité de l'action collective. C'est un drame sur la difficulté de s'accorder quand l'avenir est en jeu. »
Un héritage pour aujourd'hui
En fin de compte, « Kyoto » n'est pas seulement une pièce historique. C'est une œuvre profondément actuelle. Elle interroge sur ce que nous avons appris, ou non, depuis 1997. Les thèmes abordés – l'influence des lobbies, le fossé entre les pays riches et pauvres, la nécessité d'un leadership politique fort – sont toujours au cœur des conférences sur le climat (les COP).
La pièce se termine sur une note ambivalente. D'une part, elle célèbre le fait qu'un accord, même imparfait, a pu être atteint, suggérant que l'espoir reste permis. D'autre part, elle souligne la fragilité de ces consensus et la lenteur de leur mise en œuvre face à une crise qui s'accélère.
Le public quitte le théâtre non pas avec des réponses toutes faites, mais avec une meilleure compréhension des forces en jeu. En humanisant un événement politique majeur, « Kyoto » rappelle que l'histoire du climat n'est pas une fatalité, mais une succession de choix faits par des hommes et des femmes. Un rappel puissant à l'heure où de nouvelles décisions cruciales doivent être prises pour la planète.