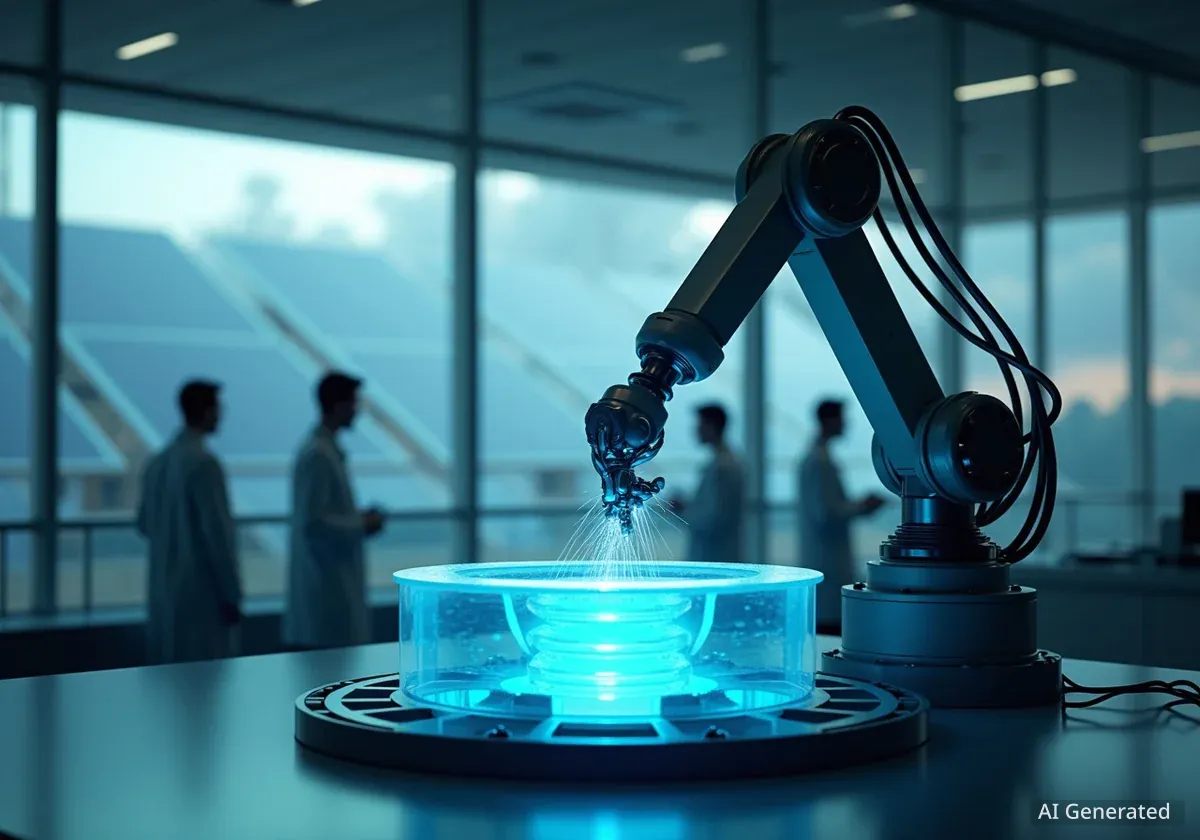Malgré l'expansion rapide des énergies renouvelables et leurs avantages écologiques et économiques, les combustibles fossiles continuent de dominer le paysage énergétique mondial. Cette persistance soulève des questions sur la capacité des pays à s'éloigner des sources d'énergie carbonées, même après trois décennies de négociations et d'accords climatiques internationaux. La demande croissante en électricité, notamment pour alimenter des technologies comme l'intelligence artificielle, ajoute une pression supplémentaire sur les gouvernements, les obligeant à concilier sécurité énergétique et objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Points Clés
- Les États-Unis relancent la production de charbon et de pétrole face à la demande énergétique.
- La Chine domine les technologies vertes mais augmente également sa production de charbon.
- L'Europe cherche à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes.
- Le Brésil, hôte de la COP30, est confronté à des contradictions entre ses engagements climatiques et son exploration pétrolière.
Les États-Unis et l'ambition des combustibles fossiles
Les États-Unis possèdent d'importantes réserves de combustibles fossiles et une industrie pétrolière et gazière influente. Depuis janvier 2025, l'administration Trump a fortement encouragé le forage pétrolier, l'extraction de gaz et la production de charbon. Ces initiatives sont justifiées par une demande énergétique en hausse, notamment pour les centres de données d'intelligence artificielle.
L'administration a relancé le slogan « drill, baby, drill » (forer, bébé, forer) et introduit une nouvelle approche « mine, baby, mine » (extraire, bébé, extraire) pour tenter de revitaliser la production de charbon américaine. Cette production avait fortement diminué ces vingt dernières années, concurrencée par le gaz naturel moins cher et les énergies renouvelables.
Le président Donald Trump a serré la main d'employés de l'industrie du charbon en avril 2025, lors de la signature d'une loi en faveur des combustibles fossiles, marquant un soutien clair à cette industrie.
Faits Importants
- Le Département de l'Intérieur a proposé, le 29 septembre, d'ouvrir 5,2 millions d'hectares de terres fédérales à l'extraction de charbon.
- Le Département de l'Énergie a promis 625 millions de dollars américains pour soutenir la compétitivité du charbon.
- Ces mesures incluent la réduction des redevances minières et la prolongation de la durée de vie des centrales au charbon.
Cependant, ces politiques enferment les communautés dépendantes des centrales au charbon dans une économie à forte intensité de carbone. La relance du charbon aurait également des coûts significatifs pour la santé publique. Sa pollution est associée à des maladies respiratoires, des maladies cardiaques et des milliers de décès prématurés chaque année aux États-Unis entre 1999 et 2020.
Recul américain dans les énergies propres
L'administration Trump réduit également les crédits d'impôt pour les énergies renouvelables et retire le soutien fédéral aux projets de recherche énergétique. Les demandes budgétaires américaines pour 2026 prévoient de réduire le financement de la recherche, du développement et de la démonstration en énergie à 2,9 milliards de dollars, soit un peu plus de la moitié du budget alloué en 2025. Ces investissements en recherche énergétique pourraient atteindre des niveaux jamais vus depuis le milieu des années 1980 ou le début des années 2000, même en tenant compte de l'inflation.
La Chine: leader des énergies propres et expansion du charbon
Alors que les États-Unis réduisent leurs financements pour les énergies renouvelables, la Chine investit massivement dans les technologies propres. Grâce à d'importantes subventions gouvernementales et à ses capacités de fabrication, la Chine domine la production mondiale de panneaux solaires et les chaînes d'approvisionnement pour les éoliennes, les batteries et les véhicules électriques.
Les technologies énergétiques propres fabriquées en Chine, moins coûteuses, ont permis à de nombreuses économies émergentes, comme le Brésil et l'Afrique du Sud, de réduire leur consommation de combustibles fossiles. En 2024, le Brésil est entré dans le top 5 mondial de la production solaire, générant 75 térawattheures (TWh) d'électricité, dépassant les 71 TWh de l'Allemagne.
Contexte International
L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) prévoit que la capacité mondiale en énergies renouvelables doublera d'ici 2030, malgré une forte baisse attendue de la croissance des énergies renouvelables aux États-Unis.
Cependant, si la Chine étend l'accès aux énergies propres dans le monde, sa production et ses émissions de charbon continuent d'augmenter. Au premier semestre 2025, la Chine a mis en service 21 gigawatts (GW) de nouvelles centrales au charbon. Les projections pour l'année complète dépassent les 80 GW, ce qui représenterait la plus forte augmentation de capacité de charbon en une décennie pour la Chine.
Bien que la Chine se soit engagée à réduire son utilisation du charbon entre 2026 et 2030, la demande énergétique croissante pourrait rendre ce plan difficile à réaliser. Ce paradoxe chinois – leader des innovations en énergies propres tout en augmentant le charbon – reflète la tension entre assurer la sécurité énergétique et réduire les émissions et l'impact climatique.
L'Europe face à la recherche de sources d'énergie fiables
L'Union Européenne met en œuvre des stratégies pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, notamment en raison des tensions géopolitiques avec la Russie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a exposé de nombreux pays à des perturbations d'approvisionnement et à une instabilité géopolitique, déclenchant une crise énergétique mondiale. Les pays autrefois dépendants du pétrole et du gaz russes ont dû chercher des alternatives.
En juin 2025, la Commission Européenne a proposé un règlement visant à éliminer progressivement les importations de combustibles fossiles russes d'ici fin 2027. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan REPowerEU. Le plan vise à augmenter la production d'énergie propre, à améliorer l'efficacité énergétique et à diversifier les approvisionnements en pétrole et en gaz pour s'éloigner de la Russie.
Les énergies renouvelables sont désormais la principale source d'énergie électrique dans l'UE. Cependant, le gaz naturel et le pétrole représentent toujours plus de la moitié de l'approvisionnement énergétique total de l'Europe.
Défis internes à la décarbonation européenne
Le plan de l'UE pour l'élimination progressive des énergies fossiles est également confronté à des défis internes. La Slovaquie et la Hongrie ont exprimé leur opposition à la proposition, citant des préoccupations concernant l'abordabilité de l'énergie et la nécessité de sources d'approvisionnement alternatives. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a déclaré que la Hongrie continuerait d'importer du pétrole et du gaz russes. Il a affirmé que couper ces approvisionnements serait un « désastre » économique et réduirait immédiatement la production économique de la Hongrie de 4%.
La réduction de la dépendance de l'Europe aux combustibles fossiles implique donc de gérer les désaccords internes et d'encourager un développement durable à long terme. L'Europe semble tirer parti du retrait américain des énergies propres. L'investissement mondial dans les énergies renouvelables a atteint un niveau record au premier semestre 2025, augmentant dans l'UE alors qu'il diminuait aux États-Unis, selon l'analyse de BloombergNEF.
Le Brésil: entre engagements climatiques et exploration pétrolière
En novembre 2025, des représentants du monde entier se réuniront au Brésil pour la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, la COP30. Cette réunion marque trois décennies de négociations climatiques internationales et une décennie depuis la signature de l'Accord de Paris visant à limiter l'augmentation de la température mondiale.
Le choix de Belém, ville située en Amazonie, comme hôte de la conférence, reflète à la fois les enjeux et les contradictions des engagements climatiques. L'Amazonie est un écosystème vital menacé d'effondrement par le réchauffement climatique. Pourtant, le Brésil, qui se veut un leader climatique, développe sa production de pétrole et de gaz et explore des gisements dans la région de Foz do Amazonas, à l'embouchure du fleuve Amazone.
Trente ans après le début des pourparlers climatiques mondiaux, le décalage entre les promesses et les pratiques n'a jamais été aussi évident. Le monde n'est pas en voie d'atteindre les objectifs de température de Paris, et la persistance des combustibles fossiles en est une raison majeure. Les négociateurs devraient débattre des mesures visant à réduire les émissions de méthane et à soutenir la transition des combustibles fossiles. Cependant, il reste à voir si les discussions se traduiront par un plan concret d'élimination progressive mondiale. Sans plans crédibles pour réduire réellement la dépendance aux combustibles fossiles, les pourparlers climatiques annuels risquent de devenir un nouveau point de tension géopolitique.