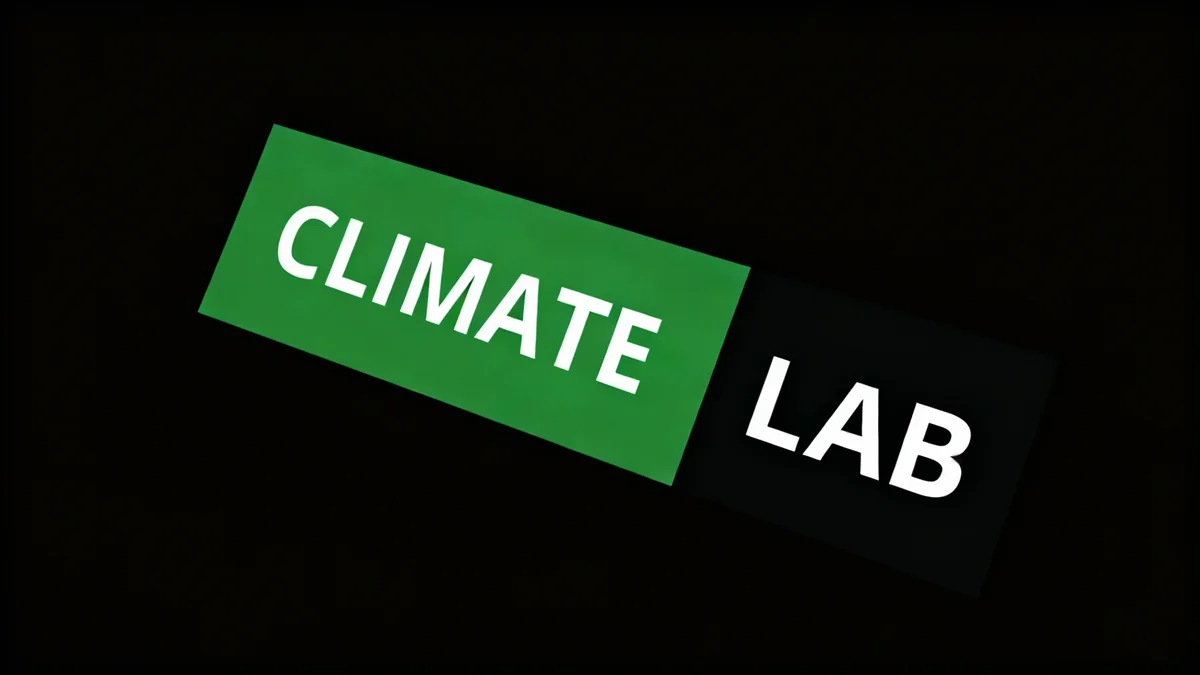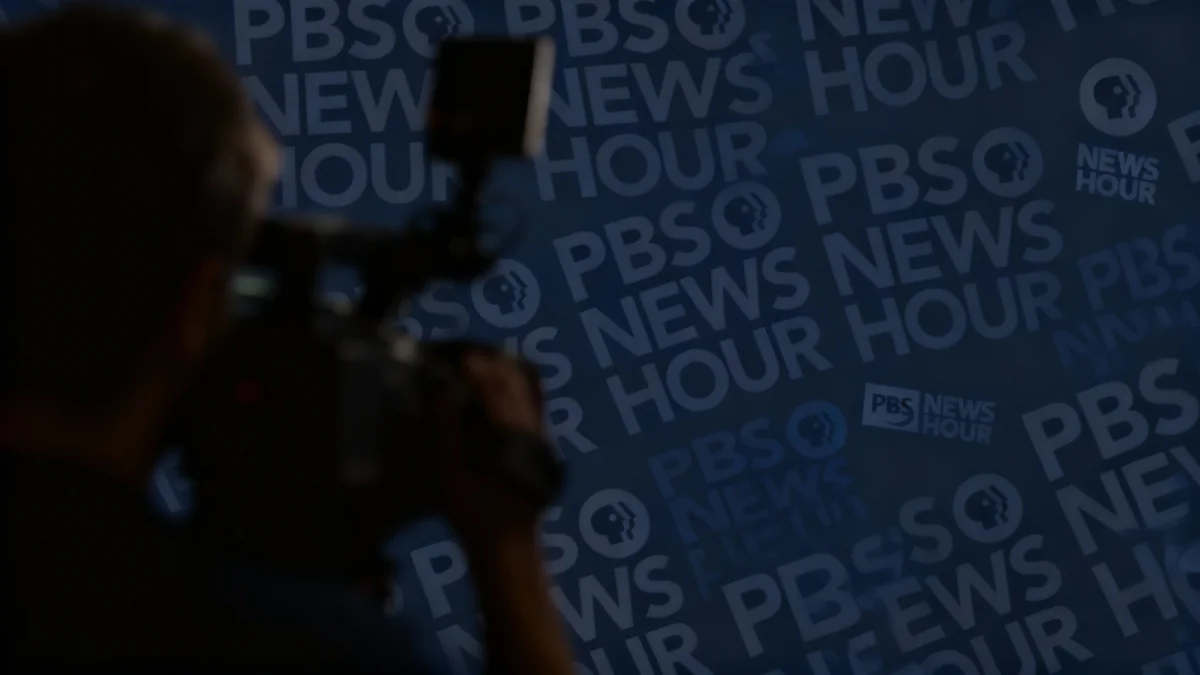Malgré les titres alarmistes sur le recul des engagements ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) des entreprises, une nouvelle étude révèle une réalité plus complexe. Sur 75 entreprises mondiales analysées, seulement 13% ont réellement réduit leurs efforts en matière de durabilité. En revanche, 85% ont maintenu ou même intensifié leurs actions, souvent de manière discrète, pour éviter l'attention politique.
Cette tendance, surnommée « greenhushing » (silence vert), montre un décalage entre la perception publique et la stratégie réelle des entreprises. Alors que certaines coalitions se dissolvent sous la pression, de nombreuses firmes continuent d'investir dans des pratiques durables, intégrant ces efforts au cœur de leurs opérations.
Points Clés
- Seules 13% des entreprises ont réduit leurs engagements climatiques.
- 85% ont maintenu ou accéléré leurs efforts de durabilité.
- Le « greenhushing » est une stratégie dominante pour éviter l'attention politique.
- L'intégration opérationnelle et la stabilité du leadership renforcent la résilience.
- L'action collective est menacée par la dissolution de coalitions.
La perception face à la réalité des engagements
Les gros titres suggèrent un abandon généralisé de l'ESG. Cependant, une étude menée d'avril 2024 à mai 2025 sur 75 entreprises mondiales, dont les 25 premières du S&P 100, du STOXX Europe et du Fortune 500, brosse un tableau différent. Cette analyse, combinée à 15 entretiens d'experts, révèle une adaptation stratégique aux pressions politiques.
La majorité des entreprises ne renoncent pas à leurs engagements. Au lieu de cela, beaucoup adoptent une stratégie de silence. Elles dissimulent leurs progrès et leurs investissements pour éviter les critiques. Ce phénomène de « greenhushing » est une réponse directe à un environnement politique de plus en plus tendu.
Statistiques Clés
- 13% des entreprises ont réduit leurs efforts de durabilité.
- 40% ont maintenu leurs efforts sans les promouvoir publiquement.
- 13% ont réaffirmé publiquement leurs engagements.
- 32% ont activement étendu leurs stratégies de durabilité.
L'impact de la pression politique
La pression politique a atteint un point critique après l'inauguration du président Trump en janvier 2024. Ses premières actions administratives ont clairement indiqué une intention de démanteler les politiques climatiques. Des enquêtes au niveau des États, des décrets fédéraux et un activisme actionnarial croissant ont créé un climat où les efforts de durabilité très visibles comportent des risques réputationnels et politiques.
Malgré cela, les entreprises n'ont pas modifié radicalement leurs efforts individuels. Elles ont plutôt abandonné les coalitions significatives. La perception d'un retrait massif est donc souvent trompeuse, car les stratégies sous-jacentes de durabilité demeurent.
Le « Greenhushing » : une stratégie dominante
Plus de la moitié des entreprises étudiées ont choisi de minimiser ou de cesser de publier leurs progrès en matière de durabilité. Elles continuent leur travail en coulisses. Cette divergence entre ce que les entreprises disent et ce qu'elles font est frappante : sur les 85% qui ont maintenu ou étendu leurs programmes, seulement 16% les ont réaffirmés publiquement.
« Ce qui ressemble à un retrait est en réalité un phénomène généralisé de 'greenhushing' qui prend racine, » expliquent les chercheurs.
Pour de nombreux dirigeants, c'est un choix calculé. Il permet de réduire l'exposition politique, d'éviter les réactions hostiles des activistes ou de contourner les complexités réglementaires. À court terme, cette tactique peut être défendable, surtout pour les entreprises opérant sur des marchés politiquement volatils.
Coût du silence stratégique
Le « greenhushing » a un coût. Lorsque les entreprises retiennent la preuve de leur engagement, elles limitent la capacité du marché à reconnaître l'excellence opérationnelle. Elles diminuent aussi le pouvoir de signalisation qui pousse la concurrence vers des normes plus élevées. Ce silence érode la confiance des investisseurs, des clients et des partenaires potentiels.
L'effondrement de l'action collective
Autrefois une force puissante pour façonner les marchés, les coalitions d'entreprises s'affaiblissent. Le secteur des services financiers en est un exemple frappant. 100% des entreprises étudiées affiliées à la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) ou à la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) ont quitté ces coalitions volontaires.
Là où le leadership conjoint amplifiait la voix des entreprises et établissait des normes industrielles, beaucoup sont aujourd'hui silencieuses ou se sont dissoutes. Le NZIA, par exemple, a été dissous en 2024. Le NZBA a suspendu toutes ses activités en juillet en attendant un vote sur sa restructuration.
- Les retraits très médiatisés attirent l'attention.
- Ils peuvent apaiser les critiques ou révéler un manque d'alignement opérationnel.
- Le résultat est un affaiblissement des plateformes qui accéléraient la durabilité.
Les coalitions ne se contentent pas d'envoyer des signaux ; elles façonnent les marchés et changent les systèmes. Elles établissent des références, des normes d'approvisionnement et accélèrent l'adoption de pratiques durables. L'éclatement de ces alliances représente plus qu'une perte symbolique ; c'est une panne du moteur concurrentiel qui transforme l'action individuelle en transformation du marché.
Facteurs de résilience en période volatile
Trois facteurs prédisent si les entreprises tiendront bon ou céderont sous la pression : le degré d'intégration opérationnelle, l'ancrage de la création de valeur et la stabilité du leadership.
1. Intégration opérationnelle
Les entreprises les moins susceptibles de reculer sur la durabilité sont celles qui l'ont intégrée dans leurs modèles opérationnels. Leurs engagements climatiques façonnent la conception des produits, les chaînes d'approvisionnement, l'allocation des capitaux et les récits des investisseurs. Dans des secteurs comme l'alimentation et les boissons (75%), la technologie (70%), la santé (67%) et les biens et services industriels (67%), les cycles d'innovation longs et les chaînes d'approvisionnement complexes rendent la durabilité indissociable de la performance.
Les entreprises B2B sont presque immunisées contre le recul. Moins de 1% ont réduit leurs engagements, tandis que 52% les ont approfondis. Cela suggère qu'une isolation de la politique de consommation et un accent sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement leur ont permis de maintenir le cap.
2. Concentration sur la création de valeur
Un facteur décisif entre les entreprises qui ont reculé et celles qui ont tenu bon réside dans l'économie. Lorsque la durabilité est intégrée au moteur de valeur, les entreprises maintiennent le cap. TotalEnergies en est un exemple. L'entreprise a maintenu ses investissements dans la transition vers les énergies renouvelables et la décarbonisation opérationnelle, surpassant ses concurrents sur les indicateurs financiers clés.
Les experts interrogés confirment cette dynamique : face à la pression politique, ceux qui ont maintenu le cap ont appliqué la même logique décisionnelle que pour tout investissement stratégique : cela renforce-t-il la compétitivité, réduit-il les risques ou génère-t-il une valeur mesurable ?
3. Stabilité du leadership
L'un des plus forts prédicteurs de la résilience des entreprises est la stabilité du leadership. Les PDG en poste depuis longtemps apportent de la discipline. Ils alignent la durabilité sur les métriques financières fondamentales. Ils protègent les stratégies des chocs politiques et saisissent les opportunités de marché plus rapidement. Parmi les PDG ayant 11 ans ou plus à la barre, 47% ont étendu ou réaffirmé les programmes de durabilité, tandis que seulement 5% les ont réduits. En revanche, 69% des nouveaux PDG (moins de trois ans en poste) ont opéré des changements réactifs.
Le risque de mal interpréter le marché
Les titres sur le retrait et l'effondrement des coalitions créent un faux signal pour le marché. Pour les dirigeants qui évaluent déjà les risques politiques et réputationnels, cela peut donner l'impression que la tendance s'éloigne de l'action climatique. Si les dirigeants interprètent ce bruit comme un feu vert pour reculer, ils risquent d'accélérer un cycle auto-réalisateur.
La montée du « greenhushing » introduit un déficit de crédibilité qui compromet la transparence et le pouvoir de l'action collective. Pour les marchés de capitaux, ce silence est un angle mort. Il masque les entreprises qui sont réellement positionnées pour réussir dans une économie à faible émission de carbone. Il affaiblit aussi les signaux dont les investisseurs ont besoin pour récompenser la performance.
L'ambiguïté stratégique et l'exposition à long terme persisteront. Les entreprises qui reculent publiquement pourraient se retrouver vulnérables aux critiques de l'ensemble des parties prenantes : investisseurs, régulateurs, influenceurs et activistes. Les vents contraires économiques, les changements de politique commerciale et l'évolution des règles de divulgation ESG pourraient exercer une pression sur les budgets et remodeler l'examen des investisseurs.
Pour de nombreux dirigeants, le « greenhushing » est un choix pragmatique… pour l'instant. Moins d'attention publique signifie moins de pression politique. Mais cela signifie aussi moins d'opportunités de façonner les normes, d'attirer les talents et de se différencier sur des marchés où les clients valorisent toujours le leadership en matière de durabilité. Plus important encore, le « greenhushing » sape la capacité à maintenir et à réactiver les coalitions.
La transparence – sur les objectifs, les progrès et les défis – est la monnaie de la collaboration. Sans elle, le tissu conjonctif qui liait autrefois les entreprises leaders s'effiloche davantage. En coalition, les entreprises peuvent définir le leadership industriel, modifier les paysages politiques et accélérer l'adoption de nouvelles technologies. Reconstruire cette influence collective dans l'environnement actuel exige de faire face au risque politique de front. Il ne s'agit pas de l'ignorer, ni d'adopter une stratégie de « greenhushing ». Il s'agit plutôt d'intégrer la durabilité si profondément dans l'entreprise que s'en écarter ruinerait l'entreprise elle-même.
Les leaders les plus résilients seront ceux qui collaborent ouvertement sur la durabilité, créant une dynamique concurrentielle où la création de valeur et l'impact collectif se renforcent mutuellement.