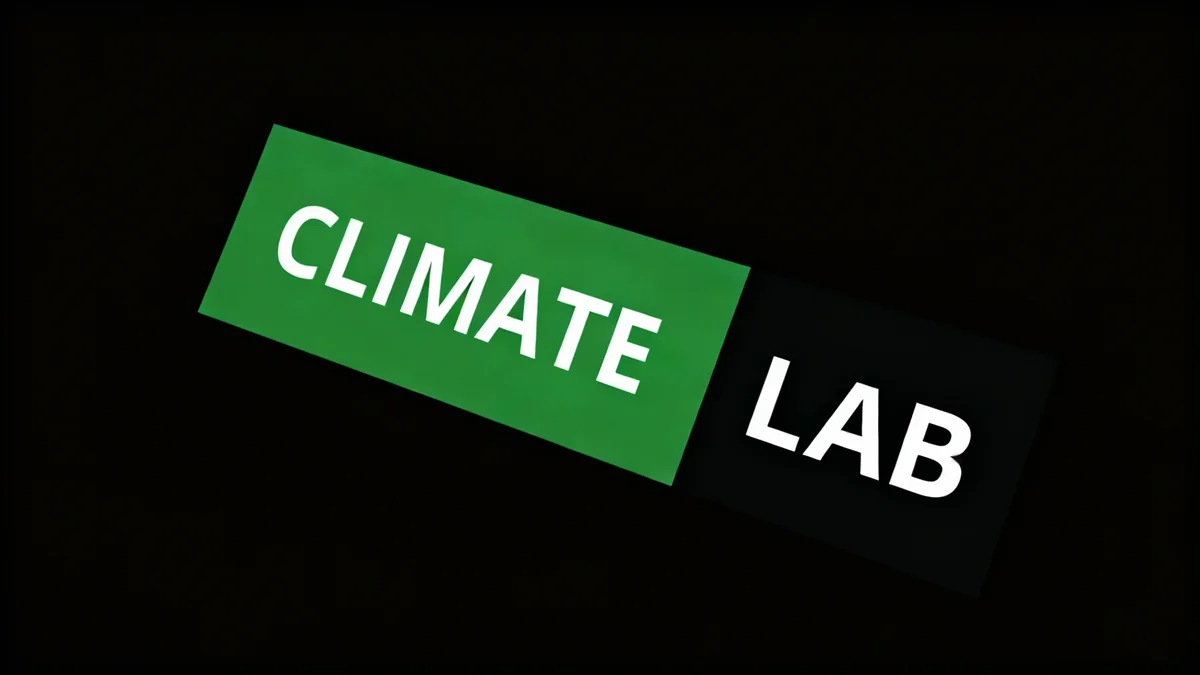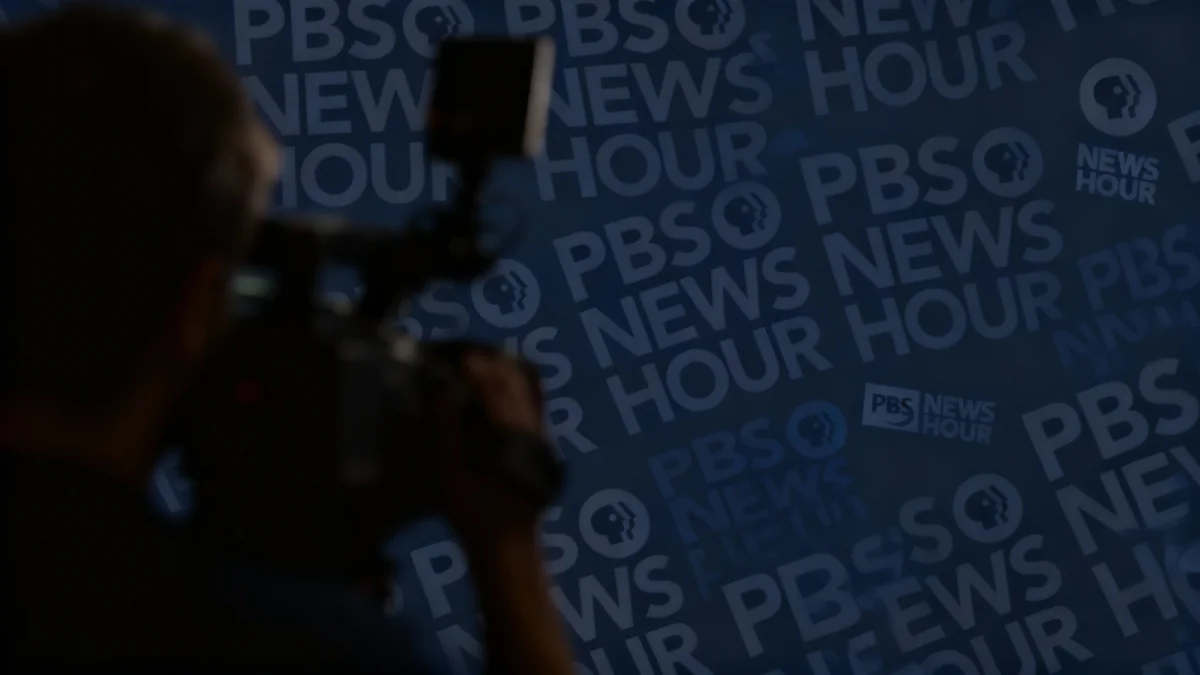Une nouvelle analyse révèle que les émissions réelles de dioxyde de carbone (CO₂) des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) sont en moyenne près de cinq fois supérieures aux chiffres officiels annoncés par les constructeurs. Cet écart, qui ne cesse de se creuser, remet en question leur rôle dans la transition écologique et représente un surcoût annuel de plusieurs centaines d'euros pour les automobilistes.
L'étude, basée sur les données des compteurs de consommation de carburant embarqués (OBFCM) de plus de 800 000 véhicules en Europe, met en lumière les failles de la réglementation actuelle et les pressions de l'industrie automobile pour l'affaiblir, menaçant ainsi les objectifs climatiques de l'Union européenne.
Points Clés
- Les émissions réelles des PHEV sont en moyenne 5 fois supérieures aux valeurs officielles.
- Cet écart a augmenté, passant d'un facteur de 3,5 en 2021 à 4,9 en 2023.
- Les conducteurs dépensent environ 500 € de plus par an en carburant et électricité que prévu.
- Même en mode "électrique", un PHEV émet en moyenne 68 gCO₂/km.
- Le lobby automobile allemand (VDA) propose d'affaiblir les normes, ce qui pourrait augmenter les émissions de 64 % d'ici 2050.
Un écart grandissant entre la théorie et la réalité
Les données officielles sur lesquelles se basent les réglementations européennes présentent une image très optimiste des véhicules hybrides rechargeables. Cependant, les informations collectées directement à partir des véhicules en circulation dressent un tableau radicalement différent.
Pour les modèles immatriculés en 2023, les émissions de CO₂ dans des conditions de conduite réelles sont en moyenne 4,9 fois plus élevées que les valeurs certifiées selon le cycle de test WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Cet écart s'est considérablement aggravé en quelques années, puisqu'il n'était que de 3,5 en 2021.
Le problème du "Facteur d'Utilité"
L'écart provient principalement d'une hypothèse erronée dans les tests officiels, appelée le "facteur d'utilité" (UF). Ce facteur est censé représenter la proportion de kilomètres parcourus en mode purement électrique. La réglementation actuelle suppose que les PHEV roulent 84 % du temps à l'électricité. Or, les données réelles montrent que cette part n'est que de 27 %.
Cette différence massive s'explique par le comportement des conducteurs, qui ne rechargent pas leur véhicule aussi souvent que les tests le supposent. La présence d'un moteur thermique et d'un grand réservoir de carburant les incite à utiliser leur voiture comme un véhicule thermique classique, surtout pour les longs trajets.
Le mythe du mode "zéro émission"
L'un des principaux arguments de vente des PHEV est leur capacité à rouler en mode tout électrique pour les trajets quotidiens. Cependant, l'analyse des données révèle que même dans ce mode, les émissions ne sont pas nulles, loin de là.
Le moteur thermique intervient souvent
En moyenne, un PHEV roulant en mode "électrique" émet tout de même 68 gCO₂/km. Cette situation est due au fait que le moteur à combustion interne se déclenche fréquemment pour assister le moteur électrique, jugé insuffisant lors de fortes accélérations, à vitesse élevée ou dans les montées.
Selon l'étude, le moteur thermique fournit de la puissance sur près d'un tiers de la distance parcourue en mode électrique. Ce phénomène est particulièrement marqué sur les modèles où le rapport de puissance entre le moteur électrique et le moteur thermique est faible.
Des performances proches des véhicules thermiques
En conditions réelles, les émissions moyennes d'un PHEV s'élèvent à 135 gCO₂/km. Ce chiffre les rapproche dangereusement des véhicules thermiques conventionnels, alors que la réglementation leur attribue des émissions 75 % plus faibles. L'écart réel de performance n'est que de 19 %.
Cette réalité a des conséquences directes pour les conducteurs, qui consomment beaucoup plus de carburant qu'attendu. La consommation en mode électrique atteint en moyenne 3 litres aux 100 km, ce qui représente un coût supplémentaire inattendu.
Un coût caché pour les consommateurs
L'écart entre les performances annoncées et la réalité ne pèse pas seulement sur l'environnement, mais aussi sur le portefeuille des automobilistes. Les promesses d'économies de carburant sont rarement tenues.
En moyenne, un conducteur de PHEV dépense environ 500 € de plus par an que ce que les chiffres officiels laisseraient supposer. Ce surcoût combine des dépenses en carburant quatre fois plus élevées que prévu et les coûts de recharge électrique.
"Les consommateurs achètent ces véhicules en pensant faire des économies et un geste pour l'environnement, mais la réalité est bien différente. Ils se retrouvent à payer bien plus cher en carburant qu'anticipé", souligne un expert du secteur.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que les PHEV sont plus chers à l'achat que de nombreuses alternatives. Une étude de Bloomberg Intelligence a révélé que le prix de vente moyen d'un PHEV en Europe était de 55 700 € en 2023, soit 15 200 € de plus qu'un véhicule 100 % électrique (BEV) de taille comparable.
Certains constructeurs bénéficient davantage de la faille
L'analyse montre que l'écart entre émissions réelles et officielles varie selon les marques. Des constructeurs comme Mercedes-Benz et Land Rover affichent des écarts nettement supérieurs à la moyenne, ce qui leur confère un avantage concurrentiel injuste pour atteindre leurs objectifs de réduction de CO₂ imposés par l'UE.
Entre 2021 et 2023, cette sous-estimation des émissions a permis à quatre grands groupes automobiles d'éviter plus de 5 milliards d'euros d'amendes potentielles.
EREV : une fausse bonne idée pour l'Europe ?
Une nouvelle catégorie de véhicules, les EREV (Extended-Range Electric Vehicles), gagne en popularité en Chine et commence à être débattue en Europe. Ces véhicules sont une variante des PHEV où le moteur thermique ne sert qu'à recharger la batterie (configuration en série).
Bien qu'ils possèdent des avantages techniques comme des moteurs électriques plus puissants et une plus grande autonomie électrique (environ 180 km), ils partagent les mêmes défauts fondamentaux que les PHEV :
- Grands réservoirs de carburant : Ils permettent de parcourir jusqu'à 900 km en mode thermique, ce qui n'incite pas à la recharge.
- Consommation élevée : Une fois la batterie vide, leur consommation de carburant est similaire à celle d'un SUV essence européen (environ 6,7 L/100 km).
- Bénéfices industriels limités : La technologie est principalement maîtrisée par des acteurs chinois, offrant peu d'avantages stratégiques pour l'industrie européenne.
Les experts estiment que les EREV ne constituent pas une solution viable à long terme pour l'Europe, où l'infrastructure de recharge pour les véhicules 100 % électriques se développe rapidement.
Les pressions pour affaiblir la réglementation
Alors que la Commission européenne doit réviser les normes d'émissions de CO₂ pour les voitures en 2026, l'industrie automobile, menée par le lobby allemand VDA, fait pression pour assouplir les règles. Leurs propositions incluent le report de l'interdiction des moteurs thermiques après 2035 et l'annulation des corrections prévues pour le facteur d'utilité.
Un risque climatique majeur
Si les propositions du VDA étaient adoptées, elles pourraient entraîner l'émission de 2,8 gigatonnes de CO₂ supplémentaires d'ici 2050. Cela représente une augmentation de 64 % par rapport aux projections basées sur la réglementation actuelle et compromettrait gravement la trajectoire de l'UE vers la neutralité carbone.
Les experts appellent les régulateurs européens à maintenir le cap. Ils recommandent de conserver les objectifs de 2030 et 2035, de sécuriser les corrections du facteur d'utilité et de les renforcer en se basant sur les données réelles. Promouvoir des technologies de transition dépassées risquerait de placer l'industrie automobile européenne dans une impasse, creusant l'écart de compétitivité avec des concurrents comme la Chine, qui investissent massivement dans les véhicules 100 % électriques.